 Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/
Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/samedi, 11 avril 2009
Céline - Hergé, le théorème du perroquet

Céline – Hergé, le théorème du perroquet
Dans son dernier ouvrage intitulé Céline, Hergé et l’affaire Haddock ¹, notre brillantissime ami Émile Brami, nous expose sa théorie sur les origines céliniennes des célèbres jurons du non moins célèbre capitaine. Même s’il ne dispose pas de « preuves » en tant que telles, l’on ne peut être que troublé par ces faisceaux qui lorgnent tous dans la même direction. En attendant l’hypothétique découverte d’une lettre entre les deux susnommés ou d’un exemplaire de Bagatelles pour un massacre dans la bibliothèque Hergé, nous en sommes malheureusement réduits aux conjectures. Pendant la rédaction de son livre, j’indiquais à Émile Brami quelques hypothèses susceptibles de conforter sa thèse. Par exemple, est-ce que le professeur Tournesol et Courtial de Pereires partagent le même géniteur ? etc. C’est un heureux hasard qui me fit découvrir un autre point commun entre le dessinateur de Bruxelles et l’ermite de Meudon. Hasard d’autant plus intéressant, qu’à l’instar de Bagatelles pour un massacre, les dates concordent. Si les premières recherches furent encourageantes, l’on en est également réduit aux hypothèses, faute de preuve matérielle.
Grâce aux nombreuses publications dont Hergé est l’objet, l’on en sait beaucoup plus sur la genèse de son œuvre. Grâce aux travaux de Benoît Mouchard ², on connaît maintenant le rôle primordial qu’a joué Jacques Van Melkebeke dans les apports « littéraires » de Tintin. Mais surtout les travaux d’Émile Brami ont permis, pour la première fois, de faire un lien entre les deux, et de replacer la naissance du capitaine Haddock et la publication de Bagatelles pour un massacre dans une perspective chronologique et culturelle cohérente. Néanmoins, il n’est pas impossible que d’autres liens entre Céline et Hergé figurent dans certains albums postérieurs du Crabe aux Pinces d’or.
Le lien le plus « parlant », si l’on ose dire, entre le dessinateur belge et l’imprécateur antisémite est un perroquet, héros bien involontaire des Bijoux de la Castafiore.
Lorsque Hergé entame la rédaction de cet album au début des années 1960, il choisit pour la première (et seule fois) un album intimiste. Coincé entre Tintin au Tibet et Vol 714 pour Sydney, Les Bijoux de la Castafiore a pour cadre exclusif le château de Moulinsart. Tintin, Milou, Tournesol et le capitaine Haddock ne partent pas à l’aventure dans une contrée lointaine, c’est l’aventure qui débarque (en masse) chez eux. Et visiblement, l’arrivée de la Castafiore perturbe le train-train habituel de nos héros. Les Bijoux de la Castafiore offre également l’intérêt d’être un album très « lourd » du point de vue autobiographique, avec des rapports ambigus entre la Castafiore et Haddock (projets de mariage), des dialogues emplis de sous-entendus (« Ciel mes bijoux ») et, au final, bien peu de rebondissements et d’action. Néanmoins, au milieu de ce joyeux bazar, émerge un élément comique qui va mener la vie dure au vieux capitaine. C’est Coco le « perroquet des îles », qui partage de nombreux points communs avec Toto, le non moins célèbre perroquet de Meudon.
Tout d’abord, il y a l’amour que Hergé et Céline portent aux animaux. L’œuvre d’Hergé est truffée de références au monde animal ; quant à Céline, il transformera son pavillon de Meudon en quasi arche de Noé… Mais revenons aux deux psittacidés. Dans les deux cas, les perroquets sont offerts par des femmes. Lucette achète le sien sur les quais de la Mégisserie. La Castafiore destine « cette petite chose pour le capitaine Koddack ». Dans les deux cas, Céline et Haddock ne sont pas particulièrement ravis de voir arriver l’animal dans leur demeure. Mais au final, ils finissent par s’y faire, voire s’en réjouissent. Céline fait de son perroquet un compagnon d’écriture, le capitaine Haddock s’en sert pour jouer un mauvais tour à la Castafiore. Autre élément commun, les deux perroquets portent presque le même nom ; « Toto » pour celui de Céline, et « Coco » (avec un C comme Céline ?) pour celui de Haddock. Certes, ce n’est pas d’une folle originalité, mais bon… Détail intéressant, les deux espèces sont différentes. Lucette rapporte à Meudon un perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus, communément appelé « Jaco » ³). La Castafiore offre un perroquet tropical (Ara ararauna 4). Autre détail intéressant, dans les deux cas, les perroquets parlent. Céline apprend au sien quelques mots, et même un couplet de chanson. Celui de Haddock se contente de répéter des phrases. Or de ces deux perroquets, le seul qui a la capacité de retenir quelques mots, et de parler, est bel est bien le perroquet gris du Gabon. Le perroquet tropical peut reproduire des sons (téléphone, moteur de voiture, etc.) mais il ne possède pas les capacités vocales que lui prête Hergé. Est-ce une erreur délibérée ? Est-ce que la documentation d’Hergé était défaillante ? Est-ce dû à l’ajout précipité du perroquet dans Les Bijoux de la Castafiore ? Cette dernière hypothèse a notre préférence.
L’autre élément qui accrédite l’hypothèse du perroquet est chronologique. La conception des Bijoux de la Castafiore et la mort de Céline sont concomitantes. Alors qu’Hergé est en train de construire l’album, Céline décède, en juillet 1961. Si peu de journaux ont fait grand cas de cette nouvelle, Paris-Match évoquera, dans un numéro en juillet et un autre, en septembre 1961, la disparition de Céline (et d’Hemingway, mort le même jour). Largement illustrés de photographies, deux thèmes récurrents se retrouvent d’un numéro l’autre : Céline et son perroquet Toto. Dans son numéro de juin, Paris Match s’extasie devant la table de travail de Céline sur laquelle veille le perroquet, dernier témoin (presque muet) de la rédaction de Rigodon... Dans le numéro de septembre, l’on peut voir la photographie de Céline dans son canapé, avec Toto, ultime compagnon de solitude.
Grâce aux biographes d’Hergé, on sait que ce dernier ne lisait pour ainsi dire jamais de livres. Quand il s’agissait de ses albums, il demandait à ses collaborateurs de préparer une documentation importante afin qu’il n’ait plus qu’à se concentrer sur le scénario et le dessin. Éventuellement, il lui arrivait de rencontrer des personnes idoines qu’il interrogeait sur un sujet qui toucherait de près ou de loin un aspect de ses futurs albums (Bernard Heuvelmans, pour le Yéti, par exemple…). Si Hergé lisait peu de livres, on sait, par contre, qu’il était friand de magazines 5 et qu’il puisait une partie de son inspiration dans l’actualité du moment. La grande question est : a-t-il eu dans les mains les numéros de Paris-Match relatant la mort de Céline ? C’est hautement probable car l’on sait qu’il lisait très régulièrement ce magazine. S’en est-il servi pour Les Bijoux de la Castafiore ? Pour cela, il suffit de comparer la photographie de Céline dans son canapé à Meudon, à celle de Haddock dans son fauteuil, à Moulinsart. La comparaison est probante.
En voyant ainsi Céline et son perroquet dans Paris-Match, Hergé s’est-il souvenu des conversations qu’il avait eu autrefois à ce sujet avec Melkebeke ou Robert Poulet ? A-t-il admiré autrefois Céline, non pas forcément comme écrivain, mais comme « idéologue » antisémite ? A-t-il décidé de faire un petit clin d’œil discret au disparu en reprenant son fidèle perroquet ? Malheureusement, il est encore impossible de répondre. Lentement, les éditions Moulinsart ouvrent les « archives Hergé » en publiant chaque année un important volume chronologique sur la genèse des différentes œuvres du dessinateur. À ce jour, ces publications courent jusqu’aux années 1943, et il faudra attendre un petit peu pour en savoir plus sur la genèse des Bijoux de la Castafiore et de son célèbre perroquet.
Reste néanmoins un élément troublant. Dans son livre, Le Monde d’Hergé 6, Benoît Peeters publie la planche qui annonce la publication des Bijoux de la Castafiore dans les prochaines livraisons du Journal de Tintin. Sur cette planche apparaissent tous les protagonistes du futur album, Tintin, Haddock , les Dupond(t)s, Tournesol, Nestor, la Castafiore, Irma, Milou, le chat, l’alouette, les romanichels, etc. Mais point de perroquet, qui pourtant a une place beaucoup plus importante que certains protagonistes précédemment cités. Hergé a-t-il rajouté Coco en catastrophe ? Coco était-il prévu dans le scénario d’origine ? Pourquoi Hergé fait-il parler un perroquet qui ne le pouvait pas ? Erreur due à la précipitation ? Ou à une mauvaise documentation ? Est-ce la vision de Céline et de son compagnon à plumes qui ont influencé in extremis cette décision en cours de création ? Détail intéressant, dans ses derniers entretiens avec Benoît Peeters, Hergé avoue qu’il aime se laisser surprendre : « J’ai besoin d’être surpris par mes propres inventions. D’ailleurs, mes histoires se font toujours de cette manière. Je sais toujours d’où je pars, je sais à peu près où je veux arriver, mais le chemin que je vais prendre dépend de ma fantaisie du moment » 7. Coco est-il le fruit de cette « surprise » ? À ce jour, le mystère reste entier, mais peut-être que les publications futures nous éclaireront sur ce point… Il serait temps ! Mille sabords !
David ALLIOT
1. Éditions Écriture. Les travaux d’Émile Brami sur Hergé et Céline ont été présentés au colloque de la Société d’Études céliniennes de juin 2004 à Budapest, et partiellement publiés par le magazine Lire de septembre 2004.
2. Benoît Mouchart, À l’ombre de la ligne claire, Jacques Van Melkebeke le clandestin de la B. D., Vertige Graphic, Paris, 2002.
3. Il est amusant de noter que ce perroquet est relativement courant dans les forêts du golfe de Guinée, et que sa répartition s’étend de l’Angola jusqu’à en Sierra Leone. Peut-être que le jeune Louis-Ferdinand Destouches en vit-il quelques-uns lors de son séjour au Cameroun…
4. Originaire d’Amérique du Sud, ce perroquet ne vient nullement « des îles », comme l’indique la Castafiore.
5. Hasard ? Les Bijoux de la Castafiore évoque justement le poids grandissant des médias dans la société.
6. Benoît Peeters, Le Monde d’Hergé, Casterman, 1983.
7. In Le Monde d’Hergé, entretien du 15 décembre 1982. Cité également par Émile Brami, p. 73.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, france, bandes dessinées, 9ème art, hergé, belgicana, belgique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 avril 2009
Entretien sur Céline avec Philippe Alméras
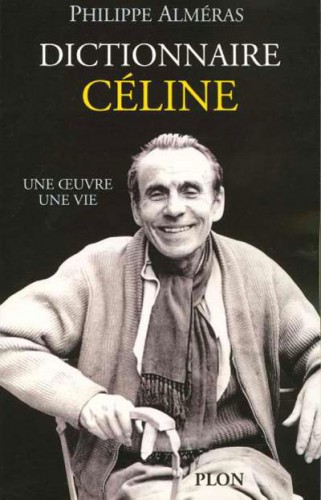
Entretien avec Philippe Alméras
Philippe Alméras est un personnage controversé dans le petit monde des céliniens. Nous avons déjà dit ici ce que nous pensions de sa biographie de Céline qui n’est assurément pas un modèle d’équanimité. Au moins lui reconnaîtra-t-on une puissance de travail peu commune. Ainsi c’est entièrement seul qu’il a rédigé un Dictionnaire Céline, coiffant ainsi au poteau les autres céliniens qui nourrissaient ce projet. Nous l’avons rencontré pour lui poser quelques questions sur un sujet qui l’occupe depuis quarante ans et dont ce dictionnaire est l’aboutissement.
Comment vous est venue l'idée de ce Dictionnaire Céline ?
Accidentellement : j'avais oublié mon ordinateur portable dans le train de Paris. Aussitôt signalée, la perte a été déclarée irréparable : « On ne retrouve jamais les ordinateurs ». J'en ai donc acheté un autre. Fourni sans la moindre notice d'instruction, naturellement. Pour apprendre à m'en servir, découvrir par exemple la touche qui mange le texte, j'ai eu l'idée de transcrire mes notes, fiches, entretiens, tout cela vieux souvent de trente ans et plus. Et l'ordre alphabétique allait de soi.
Habituellement, ce genre d'ouvrage est le résultat d'un travail d'équipe. La tâche ne vous a pas paru colossale pour un seul homme ?
À vrai dire, je ne me suis rendu compte de ce que je faisais qu'après 200 ou 300 pages. Si je m'étais mis en tête de réunir un Dictionnaire de 850 pages, le « colossal » de la chose m'aurait probablement inhibé et nous en serions encore au projet.
Si cela avait été possible, auriez- vous souhaité travailler dans une équipe ou préférez-vous, somme toute, le cavalier seul ?
Il y avait, lorsqu'une indiscrétion a révélé mon travail en cours, deux ou trois projets similaires. Quelqu'un a proposé une conjonction des données et des talents. Cela ne s'est pas fait. Je le regrette et je ne le regrette pas : ce que ce Dictionnaire aurait gagné en précision, il l'aurait sans doute perdu en spontanéité. Est-ce vraiment un hasard si ce genre de travail est toujours la responsabilité d'un seul et si les œuvres collectives aboutissent souvent à des mishi-mashi de cotes mal taillées ? Tu me laisses ceci, je t'accorde cela.
Comment avez-vous conçu ce Dictionnaire ?
Il s'est façonné de lui-même chemin faisant. Une entrée en appelait une autre, un dépouillement d'autres dépouillements. J'avais intégré les témoignages reçus, ils ont failli disparaître lorsque tel éditeur candidat les a jugés diffamatoires ou futiles.
Les céliniens vous ont souvent reproché une trop grande partialité à l'égard de votre sujet. Pensez-vous que ce Dictionnaire soit susceptible de provoquer à nouveau ce type de critiques ?
Cette partialité m'a été pour ainsi dire laissée en lot, les autres ne parlant que sources, références, tours de mains, etc. Mon premier travail visait à décrire le passage de Mort à crédit aux Bagatelles, du « roman » au « pamphlet ». Devant l'impossibilité de le faire recevoir ou même lire, je me suis obstiné à présenter mes petites trouvailles, et certains disent avec raison : la problématique de Céline a changé.
Cela dit, et cela dépassé, la forme du Dictionnaire est en soi objectivante. Elle oblige à aborder chaque chose sous ses angles divers et la promenade d'une entrée à l'autre fait le reste. Le fait même de pouvoir retrouver tel fait et telle citation et de les comparer à tels autres est en soi instructif. J'ai beaucoup appris à le faire. D'ailleurs, je ne suis pas resté seul longtemps même si le fait de dire qu'il s'agissait d'un travail personnel et subjectif a protégé l'entreprise qui ne manquait pas de concurrents.
Les notices de ce Dictionnaire ne sont pas seulement consacrées à des personnages mais aussi à des thèmes. Sur quels critères se sont fondés vos choix ?
Le premier critère était de faire figurer tout ce dont nous disposons aujourd'hui. Le second de traiter sa production sans exclusive comme cela se fait souvent au nom des bonnes mœurs ou des bons sentiments. Céline en trente ans d'activité a abordé des thèmes et des genres différents selon une progression et des modalités dont la continuité n'apparaît pleinement qu'après 1961. Au Dictionnaire de mettre cela à jour.
En quoi Céline est-il, selon vous, un grand écrivain ?
Je pourrais vous dire, comme tel autre, que le fait d'être publié dans La Pléiade est une garantie. Ce serait peut-être un peu court. Répondre qu'on le trouve prodigieusement doué, avec son goût des « diamants du langage parlé » ne serait même pas suffisant. Il ne faut pas oublier que ce qu'il dit – juste ou faux – est au moins aussi intéressant que la façon dont il le dit. Dans sa langue de prédilection – celle de la pré-Renaissance – on faisait la distinction entre « matire » et « sen ». C'est la combinaison qui fait bien sûr Céline : sans tabous ni précautions, il cite son temps comme le toréador cite le taureau. Ce n'est pas la meilleure des métaphores s'agissant de l'homme de tous les égards et de toutes les tendresses envers les animaux, mais je n'en vois dans la minute pas d'autre.
Comme le pays (lui avec) s'est refait une mémoire littéraire et historique à l'automne 44, il reste le seul à parler de ce dont il est convenu jusqu'à nouvel ordre de ne plus parler. C'est, après érosion, comme ces témoins de pierre des grands déserts d'Anatolie : indestructible.
Le fait que le Dictionnaire soit l'œuvre d'un seul auteur en fait quelque chose de très personnel : un Dictionnaire certes, mais en même une sorte de « Céline vu par Alméras ». Récusez-vous cette façon de considérer votre travail ?
Le « Céline vu par Alméras » reste encore à écrire. Il faudra que je le définisse d'abord. Ce Dictionnaire est à cette date mon travail le moins personnalisé. J'y ai rassemblé les pièces disponibles du puzzle célinien en m'efforçant d'envisager tous les angles et en donnant la parole à tout le monde. Nommément, ce qui devrait fournir à chacun l'occasion de répondre pour corriger ce qui lui paraîtra encore trop interprété. Cela devrait favoriser le rapprochement des diverses obédiences. Les clivages entre céliniens me paraissent dus à la particularité des parcours et aux options politiques prêtées à l'autre. Sur les faits tout le monde se rejoint.
En quoi ce Dictionnaire est-il aussi redevable au journaliste que vous fûtes ?
J'ai utilisé certainement des approches apprises à Réalités-Entreprise où je m'étais fait une spécialité paresseuse des portraits de dirigeants. Il existe une technique de l'interview. Dans le journalisme j'ai aussi appris le devoir absolu de ne pas ennuyer à mort le lecteur ou l'auditeur. Mais à ce compte une bonne partie des céliniens sont journalistes d'autant que tous ou à peu près tous ont interrogé les témoins du temps. Moi, quand je me suis rendu compte que je n'obtiendrais pas par cette voie la réponse à la question posée (quelles était la vision du monde et les opinions de Céline entre 1927 et 1936 ?), ce sont les textes que j'ai interrogés, et c'est le chartiste qui a découvert que – pour citer un exemple marquant – ce que Céline avait vraiment écrit dans telle lettre à Élie Faure, ce qui libérait la datation des « mauvaises idées ». Joie lorsque les photocopies ont confirmé ma radiographie. Et certitude dès lors d'aller dans la bonne direction.
La manière dont vous considérez l'homme Céline n'a pas toujours été empreinte de la plus grande bienveillance. Mais ne considérez-vous pas qu'il s'agit en l'occurrence d'une personnalité très ambivalente ? Tour à tour radin et généreux, méfiant et imprudent, courageux et timoré, cynique et sentimental, etc.
Il était effectivement tout ce que vous dites, et tout à la fois mais n'est-ce pas notre sort à tous si nous sortons du type : l'avare, le malade imaginaire, Don Juan… et si nous entrons dans la carrière sans plan à la main ? Cette question de « bienveillance » me reste toujours aussi peu compréhensible. C'est un effet du Céline entre haines et passion où j'ai mis à jour tout ce que je savais alors de la vie de Céline. M'entendre dire que j'avais écrit un livre haineux ou me voir décrit à d'innocents étrangers comme « l'auteur d'une biographie extrêmement hostile à Céline » me déconcerte alors comme maintenant. S'il s'était agi de témoigner devant un tribunal, l'exercice serait différent. Je mentirais avec l'accusé. Céline ne risque plus sa peau. Céline ne faisait pas dans l'eau tiède et rarement dans la bienveillance. Il avait le regard aigu et la dent dure. Ceux qui lui veulent le plus de mal sont à mon sens ceux qui occultent, travestissent son œuvre et font de lui un délirant : « Céline the fou » décrit dans les endroits les plus inattendus. J'ai conscience pour ma part de lui avoir rendu la santé mentale et des dents : est-ce malveillant ?
Commentant votre biographie, Henri Godard a écrit qu’on avait l’impression de lire la vie d’un second Drumont (et donc que l’accent n’était pas suffisamment mis sur l’écrivain). Que pensez-vous de cette observation ?
Êtes-vous sûr qu'il a écrit cela ? Et que cela a été imprimé ? Je ne l'ai pas lu. La seule biographie de Drumont que je connaisse est celle de Bernanos que Céline a pu lire en 1932. En voilà un qui n'hésitait pas. Il faut supposer que Godard a voulu me flatter, ce qui n'est pourtant pas son genre. Il est vrai que le lyrisme mystico-patriote de Bernanos n'est pas non plus le mien. Peut-être aussi est-ce la « grande peur » que Godard dit lui-même éprouver qui a amené Drumont sous ses doigts. Passons.
Comment jugez vous les travaux de vos confrères céliniens ? Quels ont été, de votre point de vue, les apports décisifs ?
Ils ont tous eu leur importance ou leur intérêt même si je m'attache plus aux coups de projecteurs et aux apports factuels qu'aux paraphrases et aux commentaires. Merci à ceux qui ont apporté des documents (Lainé les lettres à Garcin, Nettelbeck les lettres à Cillie Pam, Pécastaing les lettres à Zuloaga et ainsi de suite). Celui qui a fait le travail documentaire le plus important est évidemment Jean-Pierre Dauphin. On peut regretter le coup de sang ou le point d'honneur qui lui a fait quitter la partie dont il s'exagérait à mon avis les dangers et les enjeux.
Pour vous, le « fil rouge » de l’œuvre de Céline est ce racisme biologique que vous voyez apparaître très tôt et qui est présent jusque dans l’ultime Rigodon. Même si cet aspect de l’œuvre n’est pas négligeable, n’avez-vous pas l’impression d’avoir tellement mis l’accent sur ceci qu’il semble que, pour Céline lui-même, son travail d’écrivain était subordonné à cette préoccupation ?
Ce fil, c'est vous qui le voyez. Céline, personne ne le nie, a cru au corps, à la santé du corps, au dépassement du corps, comme tout le monde aujourd'hui (sport, beaux enfants, pas d'alcool), mais comme on ne le faisait pas alors. D'où les effets de rupture.
Il a ensuite étendu au groupe (aux « communautés ») la prescription aux individus. Est-ce unique ?
Comment ces conceptions qu’on dit maintenant temporaires, sans portée littéraire et donc à oublier, entrent dans l'écriture, la sous-tendent et l'orchestrent, voilà ce qu'il est permis de se demander. « L’homme, c’est le style », disait Céline et cela peut autoriser à aller de l'homme au style... Au moins le temps de voir. Surtout si, comme lui, on ne croit pas à la Littérature en soi.
Quelles sont les éventuelles critiques auxquelles vous vous attendez au sujet de ce travail ?
Vous les avez anticipées : trop personnel, trop désinvolte, trop copieux, trop léger. On chicanera des dates et des virgules. Je ne parle pas des « signes diacritiques » sans lesquels Céline nous reste imperméable. Jean-Pierre Dauphin avait eu l'idée d'assortir ses calepins de bibliographie de pages blanches ou chacun inscrivait ses apports. Si ce Dictionnaire n'avait pas déjà atteint la taille critique, j'aurais bien voulu l'imiter. Chacun aurait pu inscrire son apport, celui qu'il garde jalousement par devers lui. Les exemplaires auraient été disponibles en solde au bout de quatre ou cinq ans, on les aurait collationnés et l'on aurait « Le Dictionnaire Céline » dont nous rêvons tous : impeccable, exhaustif, unanime.
(Propos recueillis par Marc LAUDELOUT)
Comment j'ai commencé à travailler sur Céline
par Philippe Alméras
Quand j’ai commencé à « travailler sur Céline », il y en avait deux : celui d’avant 1937 et celui d’après, que certains vouaient d’ailleurs à la poubelle.
Plus le temps a passé et plus les Céline se sont multipliés. Les Anglo-Saxons parlent des neuf vies du chat. Le chat Céline en a eu bien plus, surtout si l’on ajoute celles qu’il s’est fabriquées à celles qu’on lui a prêtées.
Il a été successivement l’enfant du Passage et de la rue Marsollier, le stagiaire en langues d’Allemagne et d’Angleterre, l’apprenti commerçant, le cuirassier de Rambouillet, le combattant d’août 14, l’agent consulaire de Londres, le colon du Cameroun, le grouillot-journaliste d’Eurêka, le propagandiste antituberculeux de la Fondation Rockefeller, le bachelier éclair, l’étudiant en médecine tout aussi pressé, le mari et le père temporaire, l’hygiéniste itinérant de la SDN, le médecin en clientèle, le consultant du dispensaire à Clichy, l’auteur de théâtre, le pharmacien visiteur médical, le rédacteur de Voyage au bout de la nuit, Goncourt raté et événement littéraire de l’année 1933, le héros d’une légende misérabiliste, l’explorateur des enfances de Mort à crédit, le polémiste engagé des « pamphlets », le prophète vérifié un temps (1940-1944), l’émigré d’Allemagne puis du Danemark, le prisonnier de la Vestre Fængsel, le rural malgré lui de Korsør, le banlieusard de Meudon et l’auteur d’un come back qui n’allait pas de soi, l’écrivain restauré. Soit trois fois neuf vies de chat. Et l’enchaînement des œuvres dans une langue indéfiniment renouvelée.
À ces métamorphoses s’ajoutent les images qu’un lectorat multiple s’est faites de lui. Si les céliniens ne s’aiment guère en règle générale, c’est qu’ils ont chacun leur Céline. En 1932, Daudet le monarchiste et Descaves le nostalgique de la Commune se rejoignent certes dans l’admiration pour le Voyage, mais pas pour les mêmes raisons. L’étudiant Lévi-Strauss le voit socialiste. Bernanos le catholique lit le roman de la déréliction d’un monde sans Dieu. Décor, philosophie, tout renvoyant au peuple, certains croient à un Céline peuple et donc populiste, et c’est d’ailleurs sous cette forme que, génération après génération, il trouve chez les jeunes ses nouvelles recrues. Aujourd’hui le Voyage en poche serait encore le plus « fauché », le plus « chouré », le plus volé des livres dans un temps où les livres se volent de moins en moins. (…)
Philippe ALMÉRAS
(extrait de la préface du
Dictionnaire Céline)
Philippe Alméras, Dictionnaire Céline. Une œuvre, une vie, Plon, 2004, 880 pages.
00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 mars 2009
Hommage à Emil Cioran
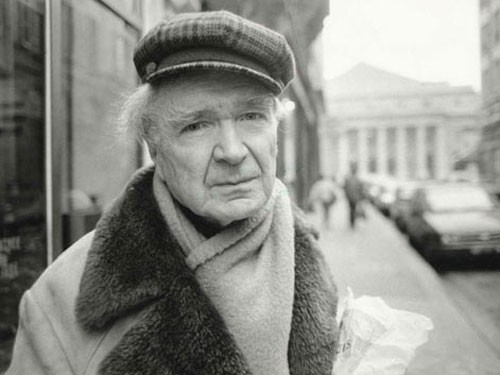
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Hommage à Emile Cioran
Au beau milieu de notre société de consommation et de plaisir, il était le héraut du déclin et du doute. L'écrivain roumain Emile Cioran est mort à Paris, à l'âge de 84 ans, le 20 juin 1995. Rien que les titres de ses livres, Précis de décomposition, Syllogismes de l'amertume ou De l'inconvénient d'être né, pourraient déclencher une dépression. Face à un homme comme Cioran, qui, selon sa propre confession, considère que toute rencontre avec un autre homme est une sorte de “crucifixion”, on est en droit de se poser la question que Nietzsche lui-même nous a suggérée: comment est-il devenu ce qu'il était?
Déjà à l'âge de dix ans, Cioran a vécu une sorte d'exclusion du Paradis. Il a dû quitter le monde de son enfance pour s'en aller fréquenter le lycée de Sibiu. Cioran décrit ce grand tournant de sa vie d'enfant: «Quand j'ai dû quitter ce monde j'avais le net pressentiment que quelque chose d'irréparable venait de se produire». Cet “irréparable” était très étroitement lié au monde simple des paysans et des bergers de son village natal. Plus tard, Cioran s'est exprimé sans ambigüité sur le monde de son enfance: «Au fond, seul le monde primitif est un monde vrai, un monde où tout est possible et où rien n'est actualisable».
Autre expérience décisive dans la vie de Cioran: la perte de la faculté de sommeil à l'âge de 20 ans. Cette perte a été pour lui “la plus grande des tragédies” qui “puisse jamais arriver à un homme”. Cet état est mille fois pire que purger une interminable peine de prison. Voilà pourquoi son livre Sur les cîmes du désespoir a été conçu dans une telle phase de veille. Cioran considérait que ce livre était le “testament d'un jeune homme de vingt ans” qui ne peut plus songer qu'à une chose: le suicide. Mais il ne s'est pas suicidé, écrit-il, parce qu'il ne pouvait exercer aucune profession, vu que toutes ses nuits étaient blanches. Elles ont été à l'origine de sa vision pessimiste du monde. Et jamais, dans sa vie, Cioran n'a été contraint de travailler. Il a accepté toute cette “peine”, cette “précarité”, cette “humiliation” et cette “pauvreté” pour ne pas devoir renoncer à sa “liberté”. «Toute forme d'humiliation» est préférable «à la perte de la liberté». Tel a été le programme de sa vie, aimait-il à proclamer.
Avant d'émigrer en France en 1937, Cioran écrivait Larmes et Saints, un livre qu'il considérait être le résultat de sept années d'insomnie. Ce que signifie l'impossibilité de dormir, Cioran l'a exprimé: la vie ne peut “être supportable” que si elle est interompue quotidiennement par le sommeil. Car le sommeil crée cet oubli nécessaire pour pouvoir commencer autre chose. Ceux qui doivent passer toutes leurs nuits éveillés finissent par segmenter le temps d'une manière entièrement nouvelle, justement parce que le temps semble ne pas vouloir passer. Une telle expérience vous modifie complètement la vie. Tous ceux qui veulent pénétrer dans l'œuvre de Cioran, doivent savoir qu'il a été un grand insomniaque, qu'il en a profondément souffert.
Les nuits de veille de Cioran sont aussi à l'origine de son rapport particulier à la philosophie. Celle-ci ne doit pas aider Cioran à rendre la vie “plus supportable”. Au contraire, il considère que les philosophes sont des “constructeurs”, des “hommes positifs au pire sens du terme”. C'est la raison pour laquelle Cioran s'est surtout tourné vers la littérature, surtout vers Dostoïevski, le seul qui aurait pénétré jusqu'à l'origine des actions humaines. La plupart des écrivains de langues romanes ne sont pas parvenu à une telle profondeur, écrivait Cioran. Ils sont toujours resté à la surface des choses, jamais ils n'ont osé s'aventurer jusqu'aux tréfonds de l'âme, où l'on saisit à bras le corps le “démon en l'homme”.
1937 a aussi été l'année où Cioran a dû reconnaître que la voie religieuse et mystique lui était inaccessible. Comme il le constatait rétrospectivement, il n'était tout simplement “pas fait pour la foi”. Car avoir la foi était au fond un don, écrivait Cioran, et on ne peut pas vouloir croire, ce serait ridicule.
Quand on prend connaissance de cet arrière-plan, on ne s'étonnera pas que Cioran revient sans cesse sur son expérience du “néant”, du “néant” qui ne devient tangible que par l'ennui. Du point de vue de Cioran, on ne peut supporter la vie que si l'on cultive des illusions. Et si l'on atteint la “conscience absolue”, une “lucidité absolue”, alors on acquiert la “conscience du néant” qui s'exprime comme “ennui”. Cependant, l'expérience de l'ennui découle d'un doute, d'un doute qui porte sur le temps. C'est à ce sentiment fondamental que pensait Cioran quand il disait qu'il s'était “ennuyé” pendant toute sa vie.
On ne s'étonne pas que Cioran avait un faible pour les cimetières. Mais ce faible n'a rien à voir avec les attitudes prises aujourd'hui par les Grufties. Pour notre auteur, il s'agissait surtout d'un changement de perspective. C'est justement dans une situation de douleur de l'âme, d'une douleur qui semble immense, démesurée, que le changement de perspective constitue la seule possibilité de supporter la vie. Quand on adopte la perspective du “néant”, tout peut arriver. Dans une certaine mesure, on en arrive à considérer comme parfaitement “normal” la plus grande des douleurs, à exclure toutes les “déformations par la douleur” qui conduisent au “doute absolu”.
Au cours des dernières années de sa vie, Cioran n'a plus rien écrit. Il ne ressentait plus l'“impérativité de la souffrance” qui fut toujours le moteur de sa production littéraire. Peut-être a-t-il tiré les conséquences de ses propres visions: nous vivons effectivement dans une époque de surproduction littéraire, surproduction absurde, totalement inutile.
Michael WIESBERG.
(trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres, littérature, lettres françaises, lettres roumaines, littérature française, littérature roumaine, france, roumanie, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 mars 2009
Le Loup et l'Agneau ou la tentation sophistique

Le Loup et l'Agneau ou la tentation sophistique
Chacun sait que le plaisir de l'écrivain réside dans l'incertitude et la difficulté. La Fontaine est un auteur difficile.
Le Loup et l'Agneau est exemplaire en ceci qu'il vient à contre-temps des autres fables du recueil, que le système de la logique fabuliste et moraliste (histoire et leçon de l'histoire) a été tourné en dérision par celui même qui s'en faisait le champion, détournant du même coup la loi morale, qui se voudrait pourtant le fondement et la direction du récit. Ce système de pensée vient évidemment en opposition à la puissante croyance officielle, et je m'en remets aux sermons et aux oraisons funèbres de Bossuet, en la divine Providence, principe de cohésion historique et personnel. L'ouverture de la Fable est avant tout un coup de théâtre, ou un coup de force: double renversement: dans la topologie du discours, la morale, contrairement à ce que l'on observe dans la majorité des Fables, ne se trouve pas à la fin, comme la déduction suit la réflexion, mais en tête. Comme s'il s'agissait d'une induction, d'une intuition. Le préfixe latin in- signifiant “dans”, la “morale” se trouverait en embryon dans l'histoire, comme pré-établie. Première surprise.
La Fontaine commence donc: “La raison du plus fort est toujours la meilleure”, mettant sur un même plan deux notions traditionnellement opposées: la force et la raison. Au premier renversement d'une fable à l'envers, s'ajoute la surprise d'une fable à rebours, par l'évocation d'une anti-morale, d'une contre-morale. L'opinion commune admet que la raison l'emporte sur la force —en tout cas dans une société policée, comme l'était celle de Louis le Grand—; a contrario, avec le fabuliste, la force est supérieure à la raison. Et l'histoire de la Fable ne le démontre pas, elle le montre.
Le seul argument du loup, c'est la faim. Et pourtant la pudeur, si chère aux contemporains de La Fontaine et si chère à la littérature galante, précieuse ou érotique, la fardera. Ce qui excusera cette appétance obscène et la légitimera, c'est l'art de la circonvolution rhétorique. Seulement l'agneau la dénichera au terme du clair-obscur de la série argumentation/réfutation. On pourrait ici démonter le mécanisme du dialogue à la fois si théâtral et si drôle, mais aussi et combien inquiétant. Le loup en serait comme un Tartuffe de la logique. Car quelle belle critique de la raison faite en ces temps de Descartes et de classicisme —le premier recueil de Fables ayant été rédigé trente ans après le Discours de la méthode... La raison érigée en escroquerie. La raison, insinue La Fontaine, est ce que l'on veut bien en faire, ce que la force veut bien faire d'elle.
Sans ignorer le point de vue sexuel de la Fable (Le petit chaperon rouge de Perrault est sur ce terrain bien comparable), La Fontaine aborde la morale et la fable à l'imitation des Anciens, mais dans une perspective sophistique. Qu'implique alors cette induction? Que la raison peut tout démontrer (qu'elle est un outil, qu'elle n'est pas une fin). Que la raison ne fait que justifier, elle n'est qu'une excuse à nos faiblesses. On en est exactement à ce que démontraient les sophistes, réputés pour soutenir sur la place publique un jour une thèse et le lendemain l'inverse: non point l'absurde de l'humaine condition —qui est postérieur, mais ce qui est rationnel est aussi affectif, que la rationalité n'est qu'une bizarrerie d'affectivité. Et plus loin: le savoir, les connaissances ne sont qu'un cumul d'affectivité “objectivée”.
Cela nous ramène à un La Fontaine inquiétant, dont se méfiait Rousseau, à juste titre, un La Fontaine libertin non-voilé (de mœurs et de pensées) où perce sous l'auteur des Fables l'auteur des Contes en vers, l'écrivain du règne des sens, du trouble et de l'irrationnel.
Le Loup et l'Agneau, Fable 10, Livre 1 (publication: 1668).
Jean-Charles ANGRAND.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, 17ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 mars 2009
Drieu La Rochelle. Il mito dell'Europa
Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa

Pierre Drieu La Rochelle (Parigi, 3 gennaio 1893 – Parigi, 15 marzo 1945)
Questo libro, edito nel lontano 1965, poi ristampato nel 1981, ed ormai reperibile nel migliore dei casi in sbiadite fotocopie, rivelò al distratto pubblico italiano la figura di Pierre Drieu La Rochelle. A questa lacuna, aveva in parte rimediato un libro di Paul Serant (Romanticismo fascista) uscito qualche anno prima, ma fu solo con questo piccolo saggio che esplose la passione per questo “poeta maledetto” del Novecento. Contemporaneamente alla scoperta in Italia della figura del “collaborazionista” La Rochelle, in Francia cominciavano ad essere ristampati i suoi testi, come in una timida, comune, primavera del pensiero anticonformista brutalmente azzittito con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale.
La Rochelle è sicuramente una personalità forte, uno scrittore dal temperamento d’acciaio, ma anche un polemista dalle grandi capacità di romanziere. Questa sua grande sensibilità fu probabilmente dovuta all’esperienza tragica nella Prima Guerra Mondiale (in cui fu ferito tre volte), e all’estrazione borghese della sua famiglia, rovinata da crisi economiche e sentimentali.
Sicuramente Drieu sapeva che non si potevano servire due “padroni”, la verità e la notorietà, scegliendo così di essere compreso bene, ma da pochi. Non a caso gli autori del libro, sottolineano la figura di questo poeta come quella del miglior Nietzsche: un’inattuale appunto, che ha lasciato fosse il fluire del tempo a dispiegare tutta la sua attualità e profeticità.
L’analisi del pensiero di La Rochelle segue così per ognuno dei tre autori una prospettiva differente: se Romualdi ne analizza la personalissima Weltanschauung, il suo esempio, identificato come militia per l’Europa, è il contributo di Giannettini, mentre Prisco si sofferma sulla storia “personale” di questo.
Dopo la crisi del ‘29, mentre tutti i suoi amici d’infanzia scelgono di abbracciare le sorti dell’Internazionale comunista, Drieu fa una scelta impopolare: egli comincia a proclamarsi apertamente fascista. Il suo fascismo è però quello di chi non può fare a meno di denunciare i mali della decadenza, di elaborare una personale rivolta contro quel “tramonto dell’occidente” già raccontato da Spengler, e dagli autori tedeschi della Rivoluzione Conservatrice.
Per questo, Drieu non fu solo un “intellettuale fascista”, come qualcuno ha voluto etichettarlo un po’ troppo semplicisticamente. Fu uno scrittore che credette di trovare una risposta alle sue domande e alle sue speranze nel fascismo o, meglio, in una certa immagine del fascismo che si era creato. Particolare fondamentale, poiché se non si tiene conto di ciò, si rischia di non capire la sua critica e lucida analisi dei regimi di Mussolini e di Hitler, e quell’atteggiamento anticonformista (appunto “maledetto”) che gli attirò le antipatie sia delle destre che delle sinistre dell’epoca.
La sua Europa non è un’Europa “neutra”: aborto esangue ed intellettuale dei federalisti di Strasburgo o d’altri democratici tout court. La sua Europa è invece quella volontà unica e formidabile, già narrata da Nietzsche, che nel sacrificio e nella stirpe, trova la sua ragion dessere. Non aveva allora torto Drieu La Rochelle, a scrivere poco prima di morire che le generazioni future si sarebbero chinate, incuriosite, sui suoi libri per cogliere un suono diverso da quello solito.
Drieu, però, a differenza di molti altri “redenti” o fascisti “pentiti”, volle pagare sino in fondo, dimostrando che ancora oggi le parole possono essere scritte «con il sangue e non solo con l’inchiostro». Avrebbe potuto fuggire come molti, starsene tranquillo per un po’ e ritornare in patria dopo qualche anno. No. Sarebbe stato troppo facile, troppo moderno per lui. Drieu La Rochelle moriva perciò suicida, il 15 Marzo 1945 nel momento della “liberazione”.
* * *
A. Romualdi, M. Prisco, G. Giannettini, Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa, Edizioni del Solstizio, 1965.
[Tratto da “il Borghese”, n.8, Agosto 2008]
Andrea Strummiello
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, fascisme, années 30, années 40, europe, européisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 mars 2009
Entretien avec Robert Poulet
 Entretien familier avec Robert Poulet : | |
| romancier de l'invisible et moraliste sans illusion Ex: http://robertpoulet.chez.com | |
| |
| |
| Un certain Marcel Proust | |
| - Quel jugement rétrospectif portez-vous sur votre carrière de critique ? | |
| - Je l'ai commencée en 1913. J'était alors étudiant à la Faculté des Mines de l'université de Liège et je donnais des petits articles à un journal qui s'appellait "L'Etudiant libéral". Récemment, j'ai retrouvé un de ces articles : il était consacré à un écrivain alors complètement inconnu, et dont le livre m'avait paru à la fois curieux et intéressant. J'avais donc écrit un article ridicule, comme on en fait à cet âge là mais dans lequel j'affirmais que c'était là un auteur à suivre, car profondément original. Le livre s'appelait "Du côté de chez Swann" et était dû à un certain Marcel Proust. Ce n'était pas mal débuter, pour un critique. Ensuite, la guerre est arrivée. Puis, j'ai entamé une brève carrière de scénariste et d'assistant-metteur en scène, au cours de laquelle je donnais aussi des articles à des revues d'avant-garde. C'est ainsi que ma carrière de critique s'est amorcée. Le jour où je suis devenu un écrivain, je me suis rapidement aperçu qu'on ne pouvais pas être que cela et j'ai donc choisi, dans le journalisme - outre la rubrique politique, par devoir de conscience - la critique littéraire, c'est-à-dire ce qui se rapproche le plus du métier d'écrivain. Pendant la seconde guerre mondiale, j'ai poursuivi assidûment cette activité, et ce, non seulement dans les journaux belges. En prison, j'ai continué à écrire. Je suis un être qui continuent volontiers !... Après, je suis rentré en France et j'ai été obligé, pour vivre, de poursuivre mon activité d'aristarque, dont je vous dirai, au risque de vous surprendre, qu'elle m'assomme. Mais on peut à la fois s'ennuyer et être honnête. À partir du moment où l'on accepte de faire ce métier-là, il faut le faire convenablement. Là, je puis constater avec satisfaction que durant cette longue période, soit depuis près de septant ans, je n'ai "raté" rien d'important, et que, d'autre part, les découvertes que j'ai eu la chance de faire se sont révélées presque toutes authentiques. | |
| - En marge de votre œuvre critique, vous avez composé une œuvre romanesque que vous qualifiez vous-même d' "itinéraire du visible vers l'invisible". | |
| - Oui. Le jour où je suis devenu romancier, c'est-à-dire lors de la publication d' "Handji", j'ai compris que le roman n'avait d'intérêt pour moi que s'il apportait une découverte importante dans la distribution des sentiments et des idées à l'intérieur de l'homme. Pour moi, tout s'est ordonné dans mon esprit en fonction d'une image qui m'est apparue avec grande force vers l'âge de douze ans, et qui était que le monde n'existe pas. Cela signifie que nous sommes devant une vision de notre esprit, occupés à rêver une aventure qui n'est pas tout-à-fait réelle. Derrière cette aventure, il y a une autre vérité, incomparablement supérieure, d'une autre nature. Pour moi, le roman consiste donc à partir de la réalité apparente pour essayer d'arriver à la "réalité réelle". Dans tous mes romans, j'ai donc cherché des chemins pour aller de l'une à l'autre, et chaque fois, en saisissant des occasions. Dans "Handji", c'est la solitude passionnée. Dans "Les Sources de la vie", c'est le contact avec l'humanité primitive. | |
| Une espèce de suicide de l'humanité | |
| - Dans "Préluse à l'Apocalypse", c'est le contact avec la fin du monde ? | |
| - En effet. Il s'agit de savoir comment le monde pourrait passer de la sensibilité vulgaire, la plus plate (je l'ai, exprès, placée aussi bas que possible) au sentiment de la dissolution dans un autre univers. Il s'agit donc d'aller de ce qui semble être à ce qui est réellement, par l'intermédiaire des catastrophes. Dites-vous que ce livre a été écrit en 1943, c'est-à-dire à une époque où personne n'avait encore pleinement vu ce à quoi la sottise et la méchanceté des hommes peuvent aboutir lorsqu'elles sont déchaînées. L'idée d'une espèce de suicide de l'humanité pouvait traverser l'esprit. Avant même la révélation décisive de la bombe atomique. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles raisons de nous ancrer dans une telle conception... | |
| - "Prélude à l'Apocalypse", c'était, en quelque sorte, de la littérature fantastique ? | |
| - Oui, mais je n'aime pas cette appellation car le fantastique consiste à s'installer dans une réalité différente. Or, moi, je ne m'y installe pas, je m'y dirige. Et, fatalement, je n'y arrive pas. Pour autant que l'on puisse le dire soi-même, "Les ténèbres" me semblent, à cet égard, le plus caractéristique de mes romans. Je m'y suis fixé pour tâche de partir de la vie pour arriver à la mort sans que le lecteur ni le héros ne s'aperçoivent du passage. Mais "Les Ténèbres" débouchent dans un tunnel où l'obscurité se fait de plus en plus profonde. C'est dire que je n'en ai pas atteint le bout. Je ne puis d'ailleurs pas le découvrir, ce bout. Cela supposerait que j'aie des vues sur un au-delà que j'ignore et que je n'appréhende - très fermement - que par la foi religieuse. | |
| - Précisement, l'aspect religieux est fondamental dans votre œuvre. Dans "Prélude à l'Apocalypse", on trouve d'ailleurs plus d'une correspondance avec l' "Apocalypse" de Saint-Jean, dont on rejoint même le texte, à la fin du roman. | |
| - C'est parce que j'ai cherché des références dans les connaissances que l'on peut avoir de l'apocalypse humaine. On trouve très peu de ces éclaircissements dans la littérature universelle. Le texte de Saint-Jean en est un mais c'est une référence trompeuse et littérairement peu efficace car elle s'articule sur des allusions devenues incompréhensibles. Cela étant, je crois tout de même être parvenu à poser des jalons, où un peu de cette réalité différente, que l' "Apocalypse" de Saint-Jean paraît décrire, s'insinue dans la réalité tout court, qui est obscurcie aujourd'hui par le rationalisme, le raidissement et l'appauvrissement de la pensée moderne. | |
| Un pessimisme gai | |
| - Vos essais sont sans doute plus connus que vos romans. Parmi ces essais figure la fameuse trilogie "Contre l'amour", "Contre la jeunesse" et "Contre la plèbe". Les titres de ces pamphlets ont permis à vos détracteurs de vous taxer abusivement de négativisme. Or il s'agit bien du contraire. | |
| - Bien sûr. Il va de soi que ces "contre" sont, en réalité, des "pour". En tant que moraliste, il s'agissait pour moi de détruire ce qui est faux pour arriver à ce qui est vrai. Si j'avais, par exemple, écrit un livre intitulé "Pour l'amour conjugal", il est bien clair qu'il n'aurait guère attiré l'attention des gens. Il fallait abattre la muraille pour voir ce qui était derrière. Il en va de même pour "Contre la jeunesse", qui est, en fait, une apologie de la maturité, pour "Contre la plèbe", qui se ramène à l'illustration et la défense de la qualité humaine. C'est à cela que j'ai voulu arriver. Je suis en train d'écrire actuellement un petit "Traité de misanthropie bien tempérée". L'idée du misanthrope qui explique comment il faut procéder pour être méchant à bon escient; cela a l'air très négatif mais je sais déjà que le dernier mot de ce livre sera le mot "charité". Comme vous voyez, ce sera une fois de plus un "contre" qui se transforme en "pour". | |
| - Vous vous considérez vous-même comme un "pessimiste gai". Qu'entendez-vous par là ? | |
| - Il y a l'idée qu'on se fait de l'homme, de la nature humaine, et puis, il y a l'idée qu'on se fait de la vie. Ce sont deux choses différentes. La connaissance que j'ai des hommes se fonde sur une expérience complète. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui aient eu l'occasion, comme je l'ai eue, de vivre dans des milieux aussi différents. J'ai été tour à tour paysan, ouvrier, soldat, prisonnier, forçat, et j'ai parcouru le monde entier. Bref, je crois être parvenu à savoir ce qu'est l'homme tel qu'il s'est présenté au bout d'un certain développement de sa race et de son espèce. J'ai résumé cela, un peu sommairement, en disant que "l'homme est une sale bête". Au fond, il est presque impossible de supporter sans agacement un autre être vivant, sauf sous le couvert d'un miracle extraordinaire qui s'appelle l'amour véritable et qui se confond, à des degrés divers, avec l'amour conjugal. C'est un de mes étonnements et de mes éblouissements les plus constants. Que l'extraordinaire égoïsme dont tout homme est pétri puisse s'ouvrir, ne serait-ce que pour un seul être, à côté de lui, c'est quelque chose de merveilleux. Je dis parfois, en plaisantant, qu'il y a beaucoup de défauts dans la création, mais que l'invention du mariage les compense tous. Ma constation est aussi celle-ci : d'une part, l'homme est une sale bête mais d'autre part il n'existe pas d'homme qui ne gagne à être connu. C'est cela que j'appelle mon pessimisme. En face de ça, il y a l'idée qu'on se fait de la vie. Récemment, je me suis aperçu, avec une certaine satisfaction, que parmi tous les livres que j'ai écrits, il y en a un bon tiers qui finissent par le mot "vie". Cela m'a frappé. Mon amour de la vie, l'extrême bonheur que j'éprouve chaque matin à me retrouver plongé dans cette aventure, se sont projetés, comme malgré moi, jusque dans mes ouvrages les plus sombres. Il y a trois ans, j'ai été très gravement malade. J'ai compris que ma substance physique en avait assez. Je puis improviser le dialogue qui s'est alors engagé entre la carcasse de Robert Poulet et Robert Poulet lui-même. La carcasse disait : "Ça suffit, laisse-moi tranquille maintenant. Je suis fatigué." Eh bien, Robert Poulet n'était pas d'accord et répondait : "Mais non, pas du tout, c'est trop intéressant. Il y a encore quelques découvertes à faire et quelques joies à éprouver". C'est ainsi que j'ai fait l'effort nécessaire pour franchir cet obstacle-là, après beaucoup d'autres. | |
| Le moment de bonheur de Céline | |
| - Au cours de votre vie, vous avez eu la chance de rencontrer les plus grands écrivains de ce siècle. Vous fûtes notamment l'ami de Céline. | |
| - Oui, je l'ai connu dès 1931, c'est-à-dire avant la révélation du "Voyage au bout de la nuit". Le Céline de cette époque était un personnage bien différent de celui des dernières années de sa vie. Il était alors joyeux, sarcastique, fort porté sur le jupon et très préoccupé de ne pas gâcher sa carrière médical. Il avait aussi un côté gandin. Certes, il ne s'habillait pas comme une gravure de modes mais il surveillait sa toilette d'assez près. L'athlète tiré à quatre épingles ne ressemble évidemment en rien au fantôme dépenaillé que j'ai vu revenir du Danemark quelques années plus tard. Que voulez-vous : il avait peur. Le personnage de Céline était la superposition d'une extrême audace d'imagination et d'une couardise physique à peu près illimitée. | |
| - Sauf en 1914, tout de même ! | |
| - Vous savez, tout le monde est courageux pendant deux ou trois jours. Mais je ne veux pas diminuer les mérites guerriers de Céline, que j'ai aimé vraiment plus que l'on aime un ami ordinaire, c'est-à-dire avec une indulgence et une tendresse particulières. Je suis aussi le seul de ses amis qu'il n'ait pas un jour insulté, fichu à la porte et traité de tous les noms. Jamais il n'a osé. Il savait que, s'il eût dit la moindre chose blessante, il ne m'aurait jamais revu. Dans "Rigodon", roman posthume paru en 1969, il y a quelques pages fielleuses, et d'ailleurs absurdes, à mon égard. Elles ne m'ont évidemment pas fait plaisir. Je les ai pardonnées à sa mémoire. Ce qui était extraordinaire, c'était de le voir travailler. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux que lorsqu'il écrivait. Pourtant, ce genre de bonheur faisait froid dans le dos. Voir Céline travailler, c'était assister au supplice des cent mille plaies. Spectacle atroce. Il s'arrachait les mots les uns après les autres comme si c'étaient des morceaux de chair. Mais il était heureux... De temps en temps, il me lisait la page qu'il avait écrite, et il avait alors son moment de bonheur. | |
| - Vous avez bien connu Montherlant également... | |
| - Nous nous voyions de loin en loin, mais très volontiers, de 1935 jusqu'à la fin de sa vie. Nous avons dîné ensemble quinze jours avant son suicide. Il m'a d'ailleurs, à ce moment-là, laissé entendre quelles étaient ses intentions et m'a dit des choses que je n'ai jamais écrites car cela aurait pu déformer l'idée qu'il voulait laisser de lui et qui était peut-être la vraie. Cependant, entre Montherlant et moi, ce n'était pas une véritable amitié car il n'était l'ami de personne. Plutôt une familiarité, un compagnonnage agréable, qui n'a pas engagé mon cœur comme ce fut le cas avec Céline, Drieu La Rochelle ou Brasillach, qui furent, pour moi, de véritables amis. Cela aussi, c'est un miracle. | |
| Propos recueillis par | |
| Marc Laudelout | |
| Le Nouvel Europe-Magazine, n° 143, mai 1982 | |
00:10 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, liitérature belge, lettres, lettres françaises, lettres belges, belgique, belgicana, critique littéraire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 mars 2009
L. F. Céline: la grande attaque contre le Verbe
Louis-Ferdinand Céline : La grande attaque contre le Verbe
Il faut, dit-il, sortir les phrases de leur sens usuel, d'un écart très léger comme on déplace une porte hors de ses gonds:
"Le style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens."
Ce "labeur" exige beaucoup de doigté. Céline enchaîne immédiatement sur sa "grande attaque contre le Verbe":
"Vous savez, dans les Ecritures, il est écrit : "Au commencement était le Verbe" Non! Au commencement était l'émotion..."
Tecniquement parlant, l'auteur décrit, par l'image, les procédés grâce auxquels il fait passer le langague parlé à travers l'écrit, pour atteindre, dit-il ailleurs, "cette espèce de prose versifiée (...) de dentelle" toute "en émotion et en violence" (1), un travail aussi "éreintant" que celui du médium en transe. Il faut gauchir, "tordre la langue tout en rythme, cadence, mots"(2). "C'est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai." (3)
Les gonds et la porte sont aussi un archétype très ancien. En posant son Verbe magique en rival de celui des Ecritures, Céline ne pouvait guère faire l'impasse sur ce point. L'idée d'axe du monde, de cycle, d'ouverture et de fermeture des portes solsticiales, tout ceci est contenu dans l'image de la porte et des gonds, nommés dans l'Antiquité par le même mot "cardo", d'où dérive le terme "cardinalis" servant à désigner les quatre directions de l'espace. Dans la symbolique romane les portes désaxées figurent une atteinte à l'âme du monde et à celle de l'homme. Le Christ, que l'Evangéliste désigne par le Verbe est dit "la Vraie Porte".
[...] La "grande attaque contre le Verbe" menée par Céline a bien d'autres finalités qu'un simple retour à la pureté des origines émotives du langage. Le métro célinien est tellement contre-nature que le colonel Réséda, à l'esprit si lent, finit par céder à la panique :
"il voit le métro sur le boulevard!... là, sur le boulevard Sébastopol!... il se cramponne... (...) Les rails!... qu'il crie, lui (...) traître! les rails!... il a dévissé tous les rails!... (...) au secours! au secours! (...) il a mis des soupirs partout!... monstre anarchiste!... vendu!... traître!... traître!..."
La vision n'est pas si délirante. Elle énonce le remède. Le colonel hurle:
"C'est le métro! (...) c'est le métro!" "Sauvez-moi! sauvez-moi tous!" "Un taxi pour l'amour de Dieu!"
Dans son accès de démence, Réséda propose une sortie du métro, au jour, il achète des fleurs, "les lys, les glaïeuls, les roses", véritable antidote. La fable ne saurait se contenter de cette fin : Réséda perd ses lys; hypocritement Céline les ramasse, mais le coeur n'y est pas :
"C'est vrai, il perdait ses fleurs!... (...) il en perd encore!... j'en ramasse..."
Récapitulons: Les Entretiens avec le Professeur Y constituent une véritable parabole de l'oeuvre célinienne, de ses tropismes, et de l'envoûtement qu'elle exerce sur le lecteur. L'auteur y livre rétrospectivement la théorie et la pratique de ses écrits, tout particulièrement leur phase "au noir" constituant sa grande période créatrice. Le renversement des valeurs diurnes, symboliquement la Surface - avec majuscule - la chute active, accélérée vers le "bout de la nuit" sont exprimés par la métaphore du métro Pigalle.
L'écrivain fera basculer ses fables pseudo-biographiques dans cet "Espace Pigalle" ainsi que toute la matière substancielle de ses romans.
Le choix dit Pascalien de Céline témoigne d'une sacralité inversive. Descendre au gouffre par le "Nord-Sud", à toute vapeur, s'y boucler avec les voyageurs en un trajet strictement nocturne analogue à la navigation des morts, signifie un renversement caractéristique de substitution de la nuit au jour. Telle est la politique qui sera celle de Céline dans Voyage au bout de la nuit, métaphoriquement et intuitivement comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, puis, bien plus tard, consciemment dans les Féerie dont les allégories offrent un véritable florilège de tous les gestes de l'Oeuvre au noir, première époque célinienne.
Les Entretiens considèrent l'état mental des voyageurs-lecteurs entraînés dans l'abîme : vivre dans les ténèbres substituées au jour sous la dictature du magicien-inventeur-ferroviaire est une situation inviable, à plus forte raison si l'auteur réussit, comme il l'a fait dans Voyage, à faire passer pour naturelle cette chute aux enfers. Céline ajoute dans un entretien avec A. Zbinden :
"Et pour tout avouer, si je me suis mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas certain que ce ne soit pas volontairement. (...) Je me suis isolé, pour ainsi dire. Isolé, c'est pour être plus en face de la "chose".
[...] Il avait de quoi s'isoler volontairement face à la "chose", la redouter, lui attribuer tous les malheurs, estimer qu'ils remontent à Voyage, "le seul livre vraiment méchant" de sa carrière... (4) C'est peut-être dans cette magie noire du Verbe qu'il faut chercher le trouble que Céline inspire. C'est peut-être la perversité, le malaise, la délectation du pacte forcé avec la nuit que certains lecteurs lui pardonnent le moins.
Source : Denise Aebersold, Goétie de Céline, SEC, 2008.
Notes
1- Lettre de Céline au Dr Camus du 24 mai 1950, citée par P. Alméras, in Dictionnaire Céline, pp 802-803.
2- Lettre du 16 avril 1947 à Milton Hindus.
3- Entretien avec Claude Sarraute, Le Monde, 1/6/1960, Cahiers Céline 2.
4- Préface à une réédition de Voyage au bout de la nuit, 1949.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, france, philosophie, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 mars 2009
Lucien Combelle
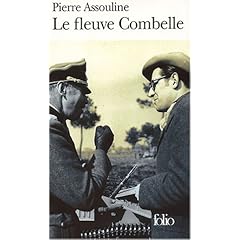
Lucien Combelle
...Voici bientôt quinze ans qu’il nous a quittés. Je n’ai dû le rencontrer qu’une ou deux fois, rue Monge où il habitait alors. C’était en compagnie de Laurence Granet qui avait soutenu, quelques années auparavant, une thèse de doctorat sur « L’idéologie fasciste dans les œuvres de Brasillach, Drieu La Rochelle, Rebatet ». Le souvenir de ces conversations s’est effacé. Je me souviens seulement du jour où, en public, il évoqua, au risque de lui nuire, son « éditeur fasciste » [sic] qui publia au début des années quatre-vingts ses souvenirs de prison. Cette sortie ne fut pas sans choquer un ami célinien qui fit cette réflexion : « Tout de même, il exagère, c’est lui qui a été fasciste ! ». Longtemps, j’ai cru que, dans son journal Révolution nationale, il s’était montré partisan d’un fascisme « libéral », je veux dire moins radical que celui prôné par ses confrères de la presse parisienne. Jusqu’à cet été 1988 où, pour annoter la correspondance que lui adressa Céline sous l’Occupation, je dépouillai, à la Bibliothèque Royale (de Belgique), la collection complète de cet hebdomadaire. Comme l’a également montré Jeannine Verdès-Leroux, qui s’est livrée au même exercice, Lucien Combelle était, bien au contraire, partisan d’un collaborationnisme sans concessions. C’est dire si Vichy n’était pas ménagé, surtout quand le régime prenait l’initiative, approuvé en cela par l’Église, de censurer en zone non occupée des écrivains jugés délétères : « Valéry, Fargue interdits. Demain Gide et Proust. Et Céline et Marcel Aymé. Et Montherlant. La France officielle semble vouloir retrouver sa beauté en avalant la jouvence de l’abbé Soury, et soigner ses blessures avec de l’eau bénite »¹. On n’est donc pas étonné de le voir dénoncer ensuite l’une des plus hautes autorités du clergé français, « Mgr Gerlier, primat des Gaules – quelle fâcheuse consonance ! – qui se permet de jouer au conseiller d’État et se mêler aux affaires de César. Monseigneur n’aime point l’antisémitisme. Monseigneur n’est pas révolutionnaire. (…) Il est démocrate et pluraliste, comme on dit. Bref, Monseigneur est, à sa manière, un dissident » ². Fustigeant le chef de l’Action française, Combelle n’y allait pas davantage de main morte : « M. Maurras a été antisémite et antidémocrate pour son bonheur et pour le nôtre. Mais, pour son malheur et pour celui de la France, M. Maurras reste germanophobe. La France, pour lui, c’est le félibrige » ³. « Révolution » est sans doute le mot qui revient alors le plus souvent sous sa plume : « Nous sommes, ou les acteurs, ou les témoins, selon une bonne ou une mauvaise fortune, d’une révolution mondiale, d’une révolution qui est née très exactement sur notre continent, dans cette Europe qui, pour notre orgueil, continue à étonner le monde » 4. « Grand garçon, intelligent, très cultivé, avec l’esprit caustique, bon avec les copains, plutôt désagréable avec ceux qui lui avaient fait dans les bottes, Combelle cultivait une pointe de cynisme » 5 : c’est ainsi que le décrit Henry Charbonneau, venu, comme lui, de l’Action française.
Après la guerre, Lucien Combelle présentera naturellement un profil nettement moins tranché. Ainsi, lors de l’émission « Apostrophes » (1978), il évoqua le « jeune fasciste sincère, de bonne foi et naïf » qu’il fut. C’est seulement chez le juge d’instruction, ajouta-t-il, qu’il découvrit ce qu’est la responsabilité des intellectuels. Philippe Alméras, qui l’avait rencontré, lui aussi, dans les années quatre-vingts, garde le souvenir de sa grande prudence : « Comme tous les ébouillantés de la Libération, il craignait l’eau froide 6 ». Céline entretint avec lui une relation du même type (un peu paternelle) que celle qu’il noua avec Henri Poulain, le secrétaire de rédaction de Je suis partout. D’une vingtaine d’années leur aîné, il ne craignait pas de les morigéner dès que paraissait dans leur journal respectif un article qu’il désapprouvait. Ainsi, à propos de cet éditorial sur (ou plutôt contre) Maurras : « Combelle fait l’enfant. Il sait aussi bien que moi l’origine de l’horreur de Maurras pour l’Allemagne – le Racisme 7. » Ou à propos d’un compte rendu du livre, Pétition pour l’histoire, d’Anatole de Monzie : « Tu dédouanes Monzie à présent et son histoire ? La merde est à ton goût ! Rien de plus pourri que ce vieux pitre – membre de la Ligue des Droits de l’Homme – membre de la Lica – grand ami de Lecache et Jean Zay ! » 8. Les exemples sont nombreux… Contrairement à Poulain, exilé en Suisse, Combelle reverra Céline. C’est seulement à la parution d’Un château l’autre qu’il reprit contact. « Tout ceci ne nous rajeunit pas ! » 9, lui répond Céline, une dizaine d’années après la tourmente qui les vit embastillés l’un à Copenhague, l’autre à Fresnes.
Marc LAUDELOUT
Notes
1. Lucien Combelle, « Avec ou sans prières », Révolution nationale, 22 août 1942.
2. Id., « Où en sommes-nous ? », Révolution nationale, 26 septembre 1942.
3. Id., « La France de M. Maurras », Révolution nationale, 31 mai 1942.
4. Id., « Ceci commande cela », Révolution nationale, 8 mai 1943.
5. Henry Charbonneau, Les mémoires de Porthos, La Librairie française, 1981 (rééd.).
6. Philippe Alméras, « Lucien Combelle relaps », Le Bulletin célinien, janvier 2006.
7. Lettre du 31 mai 1942 in L’Année Céline 1995, Du Lérot-Imec Éditions, 1996, p. 122.
8. Lettre du 21 août 1942, Ibidem, p. 127.
9. Lettre du 12 août 1957, Ibid., p. 154.
Bibliographie
Lucien Combelle est l’auteur de six livres : Je dois à André Gide (Frédéric Chambriand, 1951) ; Chansons du Mirador (Frédéric Chambriand, 1951) ; Prisons de l’espérance (ETL, 1952) ; Louis Renault ou un demi-siècle d’automobile française (La Table ronde, 1954) [signé d’un pseudonyme : Lucien Dauvergne] ; Péché d’orgueil (Olivier Orban, 1978) et Liberté à huis clos (La Butte aux cailles, 1983). Sous le titre « Céline, le pérégrin », il a préfacé un recueil de textes de Céline (Le style contre les idées, Complexe, 1987). Il a également écrit le scénario d’une bande dessinée de José Fernandez Bielsa, Quand les héros étaient des dieux (Dargaud, 1969). Au début des années 80, il avait l’intention d’écrire, en collaboration avec Laurence Granet, un Panorama des écrivains de l’Occupation ; le projet n’a pas abouti. En 1997, Pierre Assouline lui a consacré un livre, Le fleuve Combelle (Calmann-Lévy). L’année suivante, Lucien Combelle lui accorda une série de cinq entretiens dans le cadre de l’émission À voix nue sur les ondes de France-Culture (25-29 juillet 1998). Le 1er décembre 1978, à l’occasion de la parution de son livre de souvenirs, Péché d’orgueil, il participa – aux côtés de Henri Amouroux, Raymond Bruckberger, Jean-Luc Maxence et Dominique Desanti – à l’émission Apostrophes de Bernard Pivot sur le thème « Les intellectuels et la collaboration ». Il donna également son témoignage dans le film documentaire d’Alain de Sédouy et Guy Seligmann, Paris l’outragée (Antenne 2, 1989). On trouvera dans L’Année Céline 1995 (Du Lérot, 1996) la correspondance que lui adressa Céline, présentée et annotée par Éric Mazet. Plusieurs ouvrages retracent brièvement son itinéraire : Dictionnaire Céline de Philippe Alméras (Plon, 2004), Dictionnaire commenté de la Collaboration française de Philippe Randa (Jean Picollec, 1997) et Histoire de la Collaboration de Dominique Venner (Pygmalion, 2000). Sur son activité sous l’Occupation, on lira le livre de Jeannine Verdès-Leroux, Refus et violences. Politique et littérature à l’extrême droite des années trente aux retombées de la Libération (Gallimard, 1996), qui s’appuie sur une lecture de ses articles de l’Occupation.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, années 30, années 40, épuration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 mars 2009
Bulletin célinien n°306
00:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 février 2009
J. Marlaud et le renouveau païen en France

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - VOULOIR (Bruxelles) - Mai 1986
Robert Steuckers:
Jacques Marlaud et le renouveau païen en France
Le néo-paganisme européen est une jungle de concepts; pour le comprendre sous tous ses angles, il faut une connaissance approfondie des mythologies européennes, des théologies qui, sous une couverture chrétienne, renouent avec le non-dualisme anté-chrétien (Sigrid HUNKE), des littératures populaires et romantiques qui traduisent de manière romanesque ou poétique des fragments de cette vision inépuisable de l'immanence du divin. La tâche n'est pas mince et l'on n'est pas prêt de découvrir, à l'étal des libraires, une encyclopédie définitive de ce monde foisonnant de diversité.
Heureusement, Jacques MARLAUD vient de combler cette lacune, partiellement seulement (mais c'est une première étape), avec son livre, Le Renouveau païen dans la pensée française (réf. infra). La démarche de MARLAUD débroussaille la partie française contemporaine de ce continent oublié qu'est le paganisme. Sa démarche est ainsi limitée dans le temps ("la pensée contemporaine") et dans l'espace (la France). Son point de départ est la mise en évidence d'une antithèse philosophique: celle de l'idée païenne contre la pensée rationalisante. Aux schémas des rationalismes, MARLAUD oppose le retour du mythe, donc d'un polythéisme, plus apte à saisir la multiplicité du réel. Pour lui, l'utopisme et la désacralisation du monde sont les produits de l'individualisme, avatar idéologique du principe religieux judéo-chrétien du "salut individuel". A l'ère post-rationnelle, le substrat païen resurgit, à travers la croûte, le superstrat judéo-chrétiens. Les modes de vie imprégnés de christianisme, le moralisme rigide, les normes sociales sont désormais battus en brèche et ne créent plus de consensus. Et si le consensus de demain en venait à se référer au "substrat" plutôt qu'au "superstrat"?
Le résultat de ce grouillement néo-païen, c'est l'émergence progressive d'une "philosophie de l'affirmation inconditionnelle du monde", dit Jacques MARLAUD. Elle se repère chez Clément ROSSET, mais seule- ment dans le chef de l'individu et non à l'échelle collective, non chez ceux qui ont volonté de bâtir une autre Cité, imperméable aux absolus étrangers au substrat, aux absolus moribonds du superstrat d'hier.
Après avoir esquissé les grandes lignes de ce néo-paganisme, MARLAUD passe en revue les écrivains contemporains qui se situent dans cette mouvance: MONTHERLANT, GRIPARI (père d'un nihilisme déculpabilisateur qui se gausse avec espièglerie des rationalisations moralisatrices), PAUWELS le Faustien qui a "vacillé" à cause de la reaganite affligeant les médias parisiens et, enfin, Jean CAU l'anti-bourgeois qui a donné un visage enchanteur à cet existentialisme que CAMUS et SARTRE avaient rendu si lugubre.
MARLAUD survole alors la littérature française et y repère les germes de paganisme. Dans ce survol, il n'omet pas le divin RABELAIS. Et pour terminer, il passe en revue le travail de la "Nouvelle Droite" qui a popularisé, en France, les thématiques du paganisme et des racines indo-européennes. Un livre à lire pour fonder le consensus de demain...
R.S.
Jacques MARLAUD, Le Renouveau païen dans la pensée française (Préface de Jean CAU), Le Labyrinthe, Paris, 1986, 271 pages, 145 FF.
00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paganisme, nouvelle droite, religion, littérature, littérature française, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 février 2009
Marc-Edouard nabe résiste à l'Obamania
MARC-EDOUARD NABE RESISTE A L’OBAMANIA
Par Unité Populaire : http://unitepopulaire.org/
 « Ça m’étonne. Moi, si passionné par les Noirs américains et si fanatique de l’Afrique en général, je reste de marbre face à l’élection historique de Barack Obama... Ça ne me fait strictement rien. Aucune émotion, pas un tressaillement de bonheur. Suis-je devenu insensible ? Normalement, ça aurait dû me faire plaisir que le petit Blanc McCain se fasse mettre par le grand Noir Obama, je ne comprends pas... Je regarde autour de moi, ce sont des torrents de larmes. Un Noir enfin à la Maison Blanche ! Les plus durs à cuire fondent d’extase. Les incrédules sont à genoux en train de remercier le Ciel, les défaitistes chantent victoire, les revenus de tout y repartent. Pour les uns, l’élection d’Obama, c’est plus fort que le premier homme qui a marché sur la Lune. Pour les autres, c’est plus constructif que la destruction du mur de Berlin. (...)
« Ça m’étonne. Moi, si passionné par les Noirs américains et si fanatique de l’Afrique en général, je reste de marbre face à l’élection historique de Barack Obama... Ça ne me fait strictement rien. Aucune émotion, pas un tressaillement de bonheur. Suis-je devenu insensible ? Normalement, ça aurait dû me faire plaisir que le petit Blanc McCain se fasse mettre par le grand Noir Obama, je ne comprends pas... Je regarde autour de moi, ce sont des torrents de larmes. Un Noir enfin à la Maison Blanche ! Les plus durs à cuire fondent d’extase. Les incrédules sont à genoux en train de remercier le Ciel, les défaitistes chantent victoire, les revenus de tout y repartent. Pour les uns, l’élection d’Obama, c’est plus fort que le premier homme qui a marché sur la Lune. Pour les autres, c’est plus constructif que la destruction du mur de Berlin. (...)
Tout le monde adore Obama, alors forcément je suis contre... Quel rabat-joie ! Je suis bien bête de ne pas profiter de cette joie mondiale. C’est peut-être à cause de tout ce que j’entends comme conneries...Vincent Cassel dit que "tout à coup, on a envie de vivre aux États-Unis". Rama Yade minaude : "Nous sommes tous Américains, cette fois, on peut le dire dans le sens positif." Le roi du storytelling, Christian Salmon, se pâme : "Avec lui, l’Amérique qu’on aime est de retour ! ". Quant à Dorothée Werner, laide éditorialiste de Elle, elle danse carrément la samba dans sa cuisine : "Comment résister à l’euphorie qui gonfle le monde ? " D’ailleurs, pour toutes les mouilleuses du Elle, Obama c’est Cassius Clay + Robert Redford + Steve McQueen. Pourquoi ne pas ajouter James Dean et Gérard Philippe ? De plus en plus blanc à force d’additions ! Ce qu’elles veulent dire, ces blanchâtres, c’est que, dans leur idéal de Noir, Obama est une somme de soustractions : c’est Malcolm X – George Jackson – Frantz Fanon – Bobby Seale – Angela Davis... Le pompon a été décroché par Philippe Val affirmant sans rire qu’avec Obama élu, c’est enfin le XXIe siècle qui commence ; Ben Laden et son 11-Septembre, c’était encore du XXe ! D’accord, mais que des sans-couilles l’adorent ne suffit pas à expliquer que je ne bande pas. (...)
En France, le racisme est à peine caché sous l’antiracisme consensuel et les tollés des faux-derches franchouillards qui se cabrent au moindre mot de travers. En France, les racistes sont avant tout ceux qui se réjouissent qu’un Noir soit élu du moment qu’il est noir, parce que pour eux tous les Noirs se ressemblent. (...) Fin du racisme, tu parles ! Comme si les Noirs n’allaient plus être persécutés grâce à l’élection d’Obama ! On a vu comment les Arabes vivent sous le règne de Rachida Dati ! Dès qu’un métèque a un petit pouvoir, il ne pense qu’à une chose : faire du zèle contre sa race, pour montrer aux Blancs qu’il n’est pas un métèque justement, et qui paie les pots cassés ? Les autres métèques, ceux sans pouvoir ! Classique. Au pays des antiracistes auto-éblouis, le seul qui reste mesuré dans son obamania, c’est le président... Vexé comme un pou. Obama démode Sarko, Michelle écrase Carla . Premier président juif français, c’est bien. Premier président noir américain, c’est mieux. Sarkozy, qui pensait en 2007 innover dans le genre jeune loup vulgos libéralo-people s’est fait doubler un an et demi après. Comment rattraper le retard soudain pris ? En foutant des Noirs partout ! "Ne me cachez plus ces minorités visibles qu’en temps normal je n’aurais su voir..." (...)
"Obama a réalisé enfin le rêve de Martin Luther King ! " Le hic, c’est que dans son I have a dream, King disait textuellement qu’il ne voulait pas que "les gens soient jugés pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur personne". Pour quoi d’autre est jugé Barack Obama aujourd’hui ? Ce sont ses deux grands-mères qui le définissent le mieux. La première est une grosse mama qu’on a vu danser de joie en boubou dans son bidonville de Kogelo... le drapeau yankee flottant sur le Kenya. Le Kenya, terre de safaris pour beaufs, est un des rares pays d’Afrique qui ne présente aucune espèce d’intérêt. Seule la Centrafrique est plus nulle encore. Rien ne peut sortir de bon du Kenya, à part quelques Massaï qui d’ailleurs n’en sortent pas. La seconde grand-mère d’Obama, une Blanche, a toute sa vie tremblé de peur en croisant des Noirs dans les rues de Kansas City. Elle est morte la veille de son élection. Quand elle a senti que c’était inéluctable, mémé a préféré mourir... Elle ne voulait pas voir ça : un négro à la Maison Blanche, fût-ce son petit-fils !
C’est son programme peut-être qui me débecquette... Sa gestion de la crise financière ne laisse aucun doute : monsieur ne pense qu’à subventionner les banques, il veut réparer le capitalisme lui aussi, mais à l’avantage des riches. Sa priorité : rassurer les gros portefeuilles provisoirement à sec. Comme tout pratiquant du capitalisme, il est à genoux devant les banques avec l’excuse que la Banque n’est pas plus démocrate que républicaine, elle est la Banque. C’est comme Dieu, il n’est ni de gauche ni de droite, il est Dieu. Et aujourd’hui, Dieu, ce sont les trusts. Sur le dollar, il y aura bientôt écrit : In Trust we trust. C’est le pantin de l’Usure. Obama veut "sauver l’économie", c’est-à-dire les firmes et entreprises, avec la même rengaine fredonnée partout depuis le krach de septembre 2008 : "Sauvons les patrons et ils vous trouveront du boulot !" sauf que une fois que les pauvres auront aidé les riches à se renflouer, Obama et les autres chefs leur diront : "Sorry ! Il ne reste plus rien pour vous, chers pauvres... Next time ! " Pauvres pauvres !
Sur le plan international, Obama va être pire que Bush. Il suffit de voir son équipe. Tout ce qu’il a trouvé, c’est Hillary Clinton et Mme Albright, toutes les deux hyper contre Saddam, faiseuses d’anges irakiens, archi pour les guerres de 1991 et de 2003... Obama a même poussé le vice jusqu’à vouloir engager Colin Powell ! Oui la salope de l’anthrax ! Juste parce qu’il est noir, soi-disant... Pourquoi pas Condoleezza Rice ? Elle aussi est bronzata, comme dirait Berlusconi. Quel raciste, cet Obama ! Sans arrêter de sourire, il enverra plus de Noirs sur la chaise électrique, histoire qu’on ne l’accuse pas de chouchoutage... Obama va aussi travailler avec les mecs de McCain et prendre comme conseiller Joseph Biden, le stratège de John Kerry... James Jones à la Sécurité, Robert Gates à la Défense, Timothy Geithner au Trésor... Jolis messieurs ! Ce n’est plus de l’ouverture, c’est de la béance... Et ça prouve bien que dans son esprit de collabo, la politique c’est bonnet noir, noir bonnet. Tout l’espoir d’une "nouvelle Amérique" a été absorbé par sa stupéfaction d’avoir élu un Noir. Il n’y aura plus de place pour un autre "changement". Ça m’étonnerait beaucoup que le nouveau président annule le Patriot Act. À la limite, il fermera Guantanamo, qu’est-ce que ça peut lui foutre puisque d’autres pénitenciers arbitraires s’ouvriront ailleurs, directement dans les pays ennemis. Il parle déjà de rayer l’Iran de la carte. (...)
L’Irak. Obama annonce un retrait définitif des troupes pour 2011. Évidemment, ce sera reculé à 2012 où il sera remplacé par un autre salaud qui, lui, les maintiendra ! Pour le reste, son objectif est avoué dès le début : capturer Ben Laden ! Oui, cet abruti d’Hawaïen en est resté là. L’Afghanistan. Obama va y envoyer bien plus de soldats encore que Bush et ceux-là seront prélevés en Irak. Vases communicants ! Et s’il n’y en a pas assez, il en tapera à ses chers alliés qui ne pourront rien refuser à un Noir président de l’Amérique, ce pays exemplaire ! Pour finir, son directeur de cabinet est déjà nommé : Rahm Emmanuel, un engagé volontaire dans l’armée israélienne en 1991... Soyons clair : une rampouille sioniste à se damner. Pendant toute sa campagne, Obama a réitéré son soutien indéfectible à Israël. Il veut une Jérusalem israélienne, et des renforts de troupes sur le saint terrain occupé par ces sales Palestiniens... Tout pour Israël ! 78 % de Juifs Amerloques ont voté pour lui. On peut leur faire confiance: ils n’auraient pas élu un nègre s’ils n’avaient pas été sûrs qu’il soit leur man ... Non, tout ça, c’est encore du procès d’intention...
Ça y est. J’ai trouvé. Ce qui me gêne chez Obama, c’est que grâce à lui l’Amérique va redorer son blason de merde ! Yes he can, ce con. J’ai compris à quoi il va servir, ce faux Noir. L’Amérique reprend du poil de la bête, autant dire qu’elle va bientôt s’arracher les cheveux puisque la bête, c’est elle. "L’Amérique se réconcilie avec elle même et avec le monde ! " Ah, bon ? Je connais des milliards d’individus qui n’ont pas du tout envie de se réconcilier avec ce pays d’ordures... Pour en arriver à élire un Noir, c’est que les Yankees étaient à bout... Obama n’a pas été élu parce qu’il était Noir, mais parce que les Blancs au pouvoir ont compris qu’en mettant un Noir devant, l’Amérique allait pouvoir revenir au 1er rang en effaçant ses saloperies. Son image était tellement noircie par ses crimes qu’il fallait bien un Noir pour la nettoyer. Obama blanchit l’Amérique. Obama ne s’en cache pas : il veut redonner "la stature morale" de l’Amérique. En a-t-elle déjà eu une depuis le premier jour où les Espagnols débarquant ont tiré à l’arquebuse sur les Indiens venus leur apporter des fleurs sur la plage ? L’Amérique sera toujours porteuse de guerre et de mort. Kafka avait tout compris: au début de son roman L’Amérique (1911), ce n’est pas un flambeau que le héros voit dans la main de la statue de la Liberté, mais un glaive...
L’Amérique se fout d’Obama, ce qu’elle voulait, c’est faire semblant aux yeux des autres de se laver de Bush alors qu’elle l’a plébiscité deux impardonnables fois. Ne pas oublier que les pires bushistes sont ceux-là mêmes qui ont voté Obama. Logiquement, il ne devrait pas y avoir assez d’oreilles pour mettre toutes les puces dedans. Personne ne semble trouver anormal que les néoconservateurs pro-Bush se soient métamorphosés en obamiens de la vingt-cinquième heure. Il y a pourtant une raison à cela : pour mieux ré-enculer le monde, il fallait à l’Amérique un nouveau gode. Une rédemption de l’Amérique par un Noir ? Je n’y crois pas une seconde. C’est le plus mauvais cadeau fait aux vrais Afro-Américains. (...)
Il va déculpabiliser l’Amérique à peu de prix, car on s’extasie qu’il ait pu devenir président, mais qu’est-ce que c’est qu’être président des États-Unis ? C’est rien comme honneur dans le monde, c’est minable comme fonction, c’est la grosse honte ! Le plus beau jour de la vie d’un Noir, c’est d’entrer à la Maison Blanche, c’est ça le summum de la gloire ? C’est encore se soumettre en esclave, se faire reconnaître par le maître blanc, lui prouver qu’on est respectable comme lui, qu’on est son égal. Il n’était pas esclave, il vient de le devenir. Il a l’air ravi d’être enfin devenu l’esclave de l’Amérique. Le métis avait un complexe de n’être pas un bon nègre au service du maître. "Oncle Tom cherche Oncle Sam ! " Le Destin a répondu à sa petite annonce. Je sais maintenant pourquoi ce Noir me laisse froid. »
Marc-Edouard Nabe, 20 janvier 2009 (ce texte a été placardé sur les murs de Paris sous forme d’une grande affiche, selon la grande tradition révolutionnaire du pamphlet)
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : obama, etats-unis, france, lettres françaises, littérature française, littérature, lettre, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 février 2009
L. F. Céline: le cadavre bouge encore...
Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/
Louis-Ferdinand Céline : le cadavre bouge encore
 Le Figaro, 5/2/2009 : "Paul Yonnet - Un essai passionnant sur ce grand écrivain qui scandalisait parce qu'il renvoyait une peinture atroce de l'homme.
Le Figaro, 5/2/2009 : "Paul Yonnet - Un essai passionnant sur ce grand écrivain qui scandalisait parce qu'il renvoyait une peinture atroce de l'homme.Écrire sur l'astre noir de la littérature française du XXe siècle à propos duquel tout semble avoir été déjà mille fois dit et imprimé, c'est l'audacieuse intention du Testament de Céline. Le pedigree de son auteur mérite que l'on s'y arrête. Après des livres sur le travail et le loisir, le sport, la famille et l'enfant, Paul Yonnet accéda à une certaine notoriété en 1993 lors de la parution de Voyage au centre du malaise français. Cet essai visionnaire paru chez Gallimard (collection « Le Débat ») lui valut un procès en sorcellerie (accusation de « lepénisation des esprits ») et au mieux de sévères critiques, notamment de Luc Ferry - ce qui n'empêcha pas ce dernier de se retrouver plus tard en compagnie de Yonnet dans la charrette des « nouveaux réactionnaires » (Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq, Philippe Muray, Maurice G. Dantec, Alain Badiou, Renaud Camus…), rassemblant des auteurs peu soucieux de plaire aux bonnes mœurs de la pensée correcte et soumise à la vindicte publique par Daniel Lindenberg en 2002.
Décidément familier des sujets qui fâchent, Yonnet consacre donc un livre très personnel - qui tient du journal intime, de la réflexion politique et historique aussi bien que de l'étude littéraire - à cet écrivain honni et encensé, abonné à la fois aux listes noires de l'infamie collaborationniste et aux manuels scolaires.
Une indéfectible volonté d'offenser. Il confronte Céline à d'autres infréquentables aujourd'hui maudits (Maurras) ou oubliés (Bernanos). Ce dernier rendait d'ailleurs hommage au Voyage dans Le Figaro en prévenant les âmes sensibles face à « un livre dont aucun homme sensé ne recommandera la lecture à sa femme, et moins encore à sa fille ». Surtout, il soulignait la vocation de l'écrivain : «M. Céline scandalise. À ceci, rien à dire, puisque Dieu semble l'avoir fait pour ça.»
Le scandale Céline, c'est d'abord d'avoir renvoyé une peinture atroce mais vraie de la condition humaine. C'est ensuite sa fureur antisémite exacerbée dans les pamphlets et qui s'étendra même dans la presse collaborationniste à « ces antisémites de mots (…) pires que des juifs » dont « le Maurras ». Céline outrage, vomit certains racistes qu'il juge trop tièdes, se soucie peu du vitriol qu'il dispense. « Nous ne parlerions pas des pamphlets s'il n'y avait eu Voyage, mais parlerions-nous autant de Céline, et alors d'un air entendu du Voyage, supposé connu de tous, une affaire réglée, s'il n'y avait pas eu les pamphlets ? », interroge Paul Yonnet.
Au-delà du génie littéraire et de la haine antisémite, la paradoxale postérité de Céline réside dans son indéfectible volonté d'offenser, de revendiquer sa part maudite et d'offrir le visage vociférant d'un écrivain qui, dès le Voyage, a voulu dépouiller les hommes « du moindre prestige qu'on a encore tendance à leur prêter ». Mission accomplie."
00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Bulletin célinien n°305
Le Bulletin célinien
 Le Bulletin célinien, n° 305, février 2009:
Le Bulletin célinien, n° 305, février 2009:Au sommaire:
Marc Laudelout : Hommage à quatre céliniens
Dossier sur Lucien Combelle (1913-1995) : textes de Pierre Assouline, Lucien Combelle, François Gibault, Marc Laudelout, Dominique Venner.
J.-L. Aubrun : "Un grand poète épique" [1936]
Jean-Paul Louis : L'Année Céline 2007
Marc Laudelout : Censure et diffamation
Le Bulletin célinien
B. P. 70
B 1000 Bruxelles 22
http://louisferdinandceline.free.fr
Un numéro de 24 pages, 6 euros franco.
celinebc@skynet.be
00:20 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La revelacion de Emil Cioran
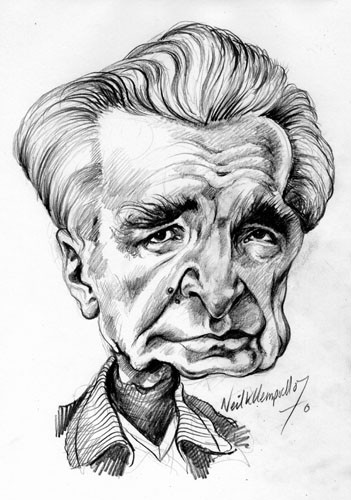
La revelación de Emile Ciorán
Abel Posse
Después de muchas horas de diálogo con Emile Ciorán, me pregunté cuál es el secreto de su atracción intelectual.
Aparentemente su negación de la filosofía académica y su defensa de un pensamiento Independiente hasta el borde de lo anárquico, podría parecer más bien un episodio final del modernismo romántico. ¿Por qué inquieta Ciorán? ¿Por qué crea adeptos mas bien rechazándoles? Se deslizó durante décadas como un antifilósofo, estimado por escritores y por un público heterogéneo pero ninguneado en el plano de la filosofía oficial, académica, "seria". ¿Cuál es la clave de su sobrevivencia y de su éxito final?
La fascinación de Ciorán a través de sus libros (y particularmente de esa obra central que es La Tentación de Existir, que acaba de ser reeditada por "Tauruo" en la magnífica traducción de Fernando Savater) se entra en subversiva sospecha del autor contra la sacralidad, la intocabilidad, el orgullo, de la condición humana misma.
Lo que nos deja Ciorán, después de la lectura de La Tentación de Existir, La Caída en el Tiempo o El Aciago Demiurgo es la de que el hombre bien podría ser tratado como un animal descastado, un indigno cósmico, en vez del semidiós, "la criatura, a su imagen y semejanza", etc,.a que se tiene acostumbrado. Es como si el hombre, a partir de Ciorán, empezase a ser considerado como una pieza de discordia cósmica, un tonto o un energúmeno infatuado que en el fondo lleva a la enfermedad y la destrucción de todo lo que toca: sean sus, pares o el planeta mismo que habita.
Lo que creo que no se expresó claramente en torno a Ciorán es que es tino de los primeros filósofos que nos dice que el hombre es una causa detestable, un asesino que se cree lleno he cualidades bondadosas.
La ética, hasta ahora, fue la respuesta creada por el hombre ante la sospecha (y la evidencia) de sus malas inclinaciones. Más allá de la respuesta de la ética está Ciorán ?que aunque no lo quiera está directamente ligado a Nietzsche? y que nos dice que el factor criminal del hombre, su destructividad, es la verdadera revelación del siglo XX: el hombre, a través de la tecnología, manifestó su verdadera faz inmoral, definitivamente pérfida: esto es el siglo de los campos de concentración, del hipócrita y cotidiano genocidio, Norte-Sur, de Hiroshima, y más que nada de la destrucción, del orden natural del planeta Tierra a través del desequilibrio ecológico, la contaminación, el definitivo avasallamiento del ritmo de la biosfera, de los animales y las plantas: por una especie triste, neurótica, infatuada, que ni siquiera obtiene placer de sus crímenes.
No es extraño que el ensayo La Tentación de Existir sea una crítico de ese, supuesto favorable a la vida humana y a la bondad del hombre que baña su hipocresía toda la cultura o incultura de Occidente.
Dice Ciorán: “Habiendo agotado mas reservas de negociación, y quizás la negociación misma, ¿por qué no debería yo salir a la calle a gritar hasta desgañitarme que me encuentro en el umbral de una verdad, de la única válida?"
Esa verdad que conmueve a Ciorán, lo separará para siempre de los bien pensantes del mundo (desde Sartre hasta Russell).
La solitaria repulsa de Ciorán se origina en este hecho central: al descalificar al hombre como ente privilegiado, loable, admirable y salvable, condena a muerte la tarea de esos filósofos del hombre, habitantes del ghetto del optimismo.
Ciorán en realidad es el primer filósofo que deja de ser "oficialista" del partido del hombre. Se pone más allá de esa obligatoria y engreída "conciencia de humanidad". Rompe el contrato, invita a que nos unamos a la opinión que de nosotros podrían tener nuestras víctimas: las plantas, los mares, los exterminados tigres de bengala, los místicos, las aves.
¿Por qué el hombre no va a ser algo prescindible en el orden de lo creado?
¿Cuál es la verdadera lectura de ese libro que sigue siendo secreto y que se llama la Biblia: qué quiere decir la parábola del ángel rebelde, la de Caín, la de la expulsión del Paraíso? ¿hemos leído bien la Biblia?
Ciorán niega al hombre actual seguir postulándose arrogantemente y sin dudas como candidato al Paraíso. Ciorán nos dice lo que muchos podemos sentir al culminar este siglo involutivo: el hombre no solamente no merece el Paraíso sino que lo saquea y destruye. Es definitivamente un animal dañoso con peligrosísimas aptitudes...
En un tiempo de pensamiento público pervertido por el lenguaje equívoco de la política y de los grandes intereses, la filosofía -la fracasada Filosofía, arrinconada a mera materia de examen, o a prestigiosa antigualla?, cobra una importancia dramática: junto con el arte y la religión son los únicos espacios de resistencia que nos quedan ante la presión cosificadora. Cosificadora no sólo por el materialismo de una "sociedad de cosas" sino porque esa sociedad termina cosificando a su protagonista, el que debería haber sido su beneficiario.)
La filosofía es guerrilla, como afirma Gilles Deleuze. Es resistencia y ataque ante un enemigo demasiado poderoso, por el momento de apariencia invencible. La guerrilla se arma en silencio y golpea cuando y donde puede.
Es el retorno al Ser y a sentirnos ser pese a la desolada, sometida versión de nuestro ser social, mejor: de nuestro aparecer.
El desdoblamiento entre el yopúblico, como escribió Bergson y el yo profundo, es un fenómeno cultural que se agudiza en este tiempo de extraordinarias y velocísimas mutaciones.
La reflexión es el mecanismo natural, privadísimo, de soldar esa peligrosa ruptura. Filosofar empieza por ser un poner esa reflexión, saber conducirla hacia objetivos. Nuestro sentimiento de existir en cuanto yo (y no en cuanto ese otro del yo publico). Filosofar es existir. En la reflexión íntima nos sentimos existir, nos sentimos en el mundo. La reflexión en estos tiempos tiene in valor similar al de la oración en este caso correo el sentimiento intimo del estar con dios, sin Dios o ante Dios).
Filosofar es existir. Nunca como ahora, en tiempos del yo volcado hacia afuera, vale y tiene tanto peso aquel cartesiano cogito, ergo sum (pienso, luego existo).
Ciorán es el gran guerrillero. Es un ejemplo de resistencia pensante. Piensa como resultado de una reflexión necesaria en un mundo en que la vida que se nos propone, tanto como las ideas hechas en torno a las que nos seguirnos moviendo, nos llevan a la despersonalización, a ese mundo de no?yos, de yos de los otros.
Frente al pensamiento de los frívolos y ruidosos noveaux philosophes de la decadencia cultural francesa, o ante las parrafadas previsibles de Popper (que en nombre del liberalismo democrático oculta la realidad del genocidio económico del tercer mundo), Ciorán se alza como el representante privadísimo e insobornable de la verdadera filosofía: coraje para el compromiso con la verdad, o mejor, con lo verdadero. Hemos llegado a tal punto de ceguera subcultural que Ciorán, el negativo se erige en posibilidad de dignificación.
![]()
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres, lettres roumaines, lettres françaises, littérature, littérature roumaine, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 février 2009
A propos de Céline et Karl Epting

À propos de Céline et Karl Epting
On conviendra qu’en étant l’éditeur, il m’est difficile de commenter le livre sur Céline et Epting ¹. Aussi je me bornerai à évoquer quelques réactions vues dans la presse et surtout sur la toile. Le tirage limité imposa un service de presse réduit et, ipso facto, la réception critique.
P.-L. Moudenc note que « Céline épistolier s'y montre tel qu'avec la plupart de ses autres interlocuteurs : surtout préoccupé de réalités matérielles, obtention de papier pour la publication de ses livres, visas pour se rendre au Danemark en passant par Berlin, paiement de droits d'auteur par son éditeur allemand. À l'occasion, il présente une requête pour un ami victime de la censure. S'il se risque à des considérations plus générales, c'est pour déplorer, en juillet 1943, que la collaboration ait été ratée “ par erreur et sottise dès le début, et entêtement et prétention par la suite ”. Nul propos antisémite ou vraiment raciste — sinon une interrogation sur l'hypothétique ascendance de Racine “ dont le théâtre n'est qu'une fougueuse apologie de la Juiverie ”, antienne reprise depuis Bagatelles. En ce domaine, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tant pis pour les ennemis forcenés d'un Ferdinand prétendu doctrinaire. Voire, comme le prétendait l'Agité du bocal (Sartre), stipendié par les nazis. Les textes d'Epting, écrits entre 1944 et 1963, sont ceux d'un témoin qui a saisi l'importance quasi universelle de l'écrivain dans la littérature de son siècle : “La critique culturelle de Céline, écrit-il à juste titre, représente l'un des grands contrepoints au développement de la civilisation rationaliste, technique et industrielle des années 1930 et 40, au témoignage plus profond et humain que des centaines d'analyses sociologiques, dont nous avons pu prendre connaissance depuis.” » ².
Ce que Moudenc trouve négligeable est, au contraire, mis en évidence par Pierre Assouline sur son blog. Son commentaire est, en effet, intitulé : « Quand Louis-Ferdinand Céline dénonçait Racine aux Allemands ». À propos de la publication de cette correspondance, il estime qu’elle vaut le détour pour deux raisons : « D’abord parce que l’auteur Frank-Rutger Hausmann, professeur de langue et littérature française à l’université de Fribourg-en-Brisgau, y apporte l’éclairage qui manquait sur la personnalité et les idées de Karl Epting, personnage clé de la collaboration intellectuelle franco-allemande sous l’Occupation, directeur de l’Institut allemand qui ouvrit ses portes dès le 1er septembre 1940 en l’hôtel Sagan, rue de Talleyrand (VIIème) afin d’y organiser des expositions, des conférences, des concerts et y recevoir le gratin littéraire parisien qui le bouda d’autant moins que la propagande pour la Nouvelle Europe avait le bon goût de n’y être pas ostentatoire. Epting, parfait francophone (difficile de parler de francophilie quand celle-ci arrive juchée sur des chars) fut un célinien inconditionnel dès la parution du Voyage au bout de la nuit en 1932 et le resta jusqu’à sa mort. Manifestement “ensorcelé” par l’écrivain, il admirait en lui l’héritier de Rabelais. Il ne cessera de le défendre contre ses compatriotes (Abetz, Payr…) qui lui reprochait son style hystérique, vulgaire, populaire et ordurier, pour ne rien dire de l’immoralité du fond. Quelques articles de ce célinien absolu sont reproduits à la fin. » À propos des soupçons de Céline à l’égard de Racine, il précise que « naturellement, la généalogie de Jean Racine a été maintes fois étudiée, par Raymond Picard notamment, et cette spéculation y est évoquée comme peu probable, ainsi que l’indique Arina Istratova dans ses précieuses notes en bas de page. Elle y rappelle également, en puisant aux meilleures sources, que si la Comédie-Française a bien monté entre 1940 et 1944 huit pièces de Molière et six de Corneille, il n’y en eut que deux de Racine (Andromaque et Phèdre) ³ ». L’intérêt du blog d’Assouline, l’un des plus fréquentés de la blogosphère, c’est qu’il reproduit les commentaires des internautes. Cette note de lecture en a suscité d’abondants, le pire côtoyant le meilleur. Comme on s’en doute les anticéliniens primaires n’ont pas manqué de se déchaîner. Bref florilège : « Je suis toujours étonné, pour ne pas dire scandalisé, que l’on puisse encore apprécier un tel type !!! » ; « Comment un esprit aussi épais dans sa vie ne le serait-il pas dans ses écrits et, de fait, il l’est, épais, son style est époustouflant mais sa voix d’auteur est obsessionnelle, paranoïaque, elle le révèle. » ; « Ce type relevait de la psychiatrie et d’un traitement carabiné. » ; « Ce vieux couillon blême de Céline, s’il avait pu lire, de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé (Fayard), il l’aurait sans doute moins ramené sur le sujet… » ; « Encore Céline ! Cet espèce de con monstrueux, avare et grossier personnage ! Les propos de Céline sont toujours du même niveau, et dans tous les domaines. Il faut vraiment en avoir une sacré dose pour croire que cet idiot ait été un écrivain. Lâchez nous un peu les baskets avec ce monstre de foire ! ». Fermez le ban !
Assurément plus nuancé, et tout aussi révélateur, le commentaire suivant : « Je me souviens, ayant lu Les Idées de Céline d’Alméras et sa biographie, n’avoir pu rouvrir aucun des livres de Céline pendant des années, rejet que n’avaient produit ni le Vitoux ni le Gibault. C’est l’enthousiasme d’un de mes amis, relisant Mort à crédit, qui m’a incité à le reprendre. Je l’ai relu en deux jours, estomaqué par son génie. En fait, le problème de Céline est insoluble. Il est sans excuses et il est immense. Il est aussi souvent délirant, c’est très frappant dans les Lettres de prison, comme s’il était allé trop loin dans l’exploration de la réalité, si loin qu’il ne s’agit plus du tout de réalité mais d’un magma puant d’où s’exhalent de préférence les pires saloperies. La question de Racine semble au premier abord à part, bouffonne, sans grande portée. Est-ce qu’il ne se fout pas un peu du monde en dénonçant un écrivain mort depuis près de 250 ans ? Sinon, je serais tenté d’y voir un acte de soumission absolue au vainqueur, un reniement total de sa propre culture et de ses fondements, à peu près sans exemple, bien moins drôle qu’il n’y paraît d’abord et finalement très grave. Imagine-t-on un Allemand, au cas où la France aurait occupé l’Allemagne, allant dénoncer Goethe ? ».
Sur un autre blog 4, un célinien, lui aussi anonyme mais reconnaissable entre tous comme nous l’avons déjà écrit, s’interroge : « Epting, francophile ? C'est passer sous silence les livres qu'il écrivit contre les Français entre 1934 et 1940 sous divers pseudonymes. Epting, “conservateur chrétien” parce qu'il écrit après guerre dans un journal qui a pour titre Christ und Welt – mais qui était dirigé par l'ancien rédacteur en chef de Signal 5 ? Hum… C'est blanchir Epting pour noircir Céline ? Ce n'est pas de sang dont parle Céline à propos de Racine, mais de nom, d'ancêtres, et d'inspiration poétique, d'un théâtre reposant sur le thème de l'amour, en opposition aux pièces de Corneille ou de Molière. » Quant à Philippe Alméras, cité par Assouline dans son commentaire, notre internaute ne décolère pas et en profite pour cibler, mais sans les nommer ceux-là, de prétendus céliniens : « Alméras, spécialiste de Céline ?... Pas moins qu'un autre… mais pas plus qu'un autre… et on en compte un nouveau tous les ans, tous les six mois, de spécialiste de Céline… à chaque nouveau livre... Il suffit de ressortir des lettres déjà publiées il y a vingt ans, d'y ajouter trois photos jusque là éparpillées dans diverses publications, d'appeler le tout “dossier inédit”, d'envoyer le tout à divers journalistes qui n'ont pas le temps de vérifier la qualité de la marchandise, et vous voilà consacré “spécialiste de Céline” auprès des néophytes. Ce n'est pas très nouveau. C'est la loi du commerce et de la publicité. C'est ce qu'on appelle aussi de la compilation et de la divulgation. Rien à voir avec la recherche. De la divulgation, il en faut, bien sûr... C'est même essentiel... Mais faudrait tout de même pas confondre. Le Dictionnaire Céline d'Alméras, sous son beau ramage et son beau plumage, est inutilisable par les étudiants ou les chercheurs céliniens tant il recèle d'erreurs, de contrevérités, de partis pris, d'approximations, de citations tronquées, d'interprétations fallacieuses et spécieuses. Un livre entièrement à refaire. Pas à corriger ! à refaire ! Les gens sérieux pourront faire la comparaison avec le Dictionnaire de Gaël Richard. Les jésuites diront : “C'est pas pareil...” En effet, ce n'est pas pareil ! Il y a le travail de première main et celui de seconde main. La recherche et la compilation. »
Revenons à Epting à propos duquel Frédéric Saenen se demande si « les premiers germes d’un célinisme digne de ce nom » ne seraient pas apparus sous sa plume : « On serait en droit de se poser la question, au vu de la pertinence des analyses qu’il développe, notamment dans ses articles au quotidien Christ und Welt. Sa vision de l’homme-Céline est elle aussi empreinte d’une lucidité confondante. Epting, en intitulant sa contribution aux Cahiers de L’Herne de 1963 « Il ne nous aimait pas », allait lancer une formule qui tranchait définitivement avec l’image d’un Céline thuriféraire du Grand Reich et de la Germanité. Il en profite aussi pour souligner la dynamique de cette si étonnante « contradiction intérieure » qui rendait le personnage à la fois attachant et infréquentable : « le contraste profond entre sa prise de position à l’égard des collectivités impersonnelles […], dans laquelle il pouvait être d’une cruauté qui, dans ses propos, allait jusqu’au paroxysme et son comportement à l’égard de l’individu concret, homme ou bête, dans lequel il n’a jamais cessé de rester le médecin et le protecteur. » Et Saenen de conclure : « Céline ? Un Docteur Jekyll et un Écrivain Hyde ! Cela fait soixante ans qu’on vous le dit… 6 »
Marc LAUDELOUT
Notes
1. Frank-Rutger Hausmann, L.-F. Céline et Karl Epting, Le Bulletin célinien, 2008, 146 p. Édition établie par Arina Istratova. Tirage limité à 410 exemplaires. 35 €, franco.
2. P.-L. Moudenc, « La bibliothèque célinienne s’enrichit encore », Rivarol, 19 décembre 2008.
3. Pierre Assouline, « Quand Louis-Ferdinand Céline dénonçait Racine aux Allemands », La République des livres, 12 décembre 2008 [http://passouline.blog.lemonde.fr]
4. Commentaire anonyme, 15 décembre 2008, à propos de « “ Quand Céline dénonçait Racine aux Allemands ” par Pierre Assouline », Entre guillemets…,13 décembre 2008 [http://ettuttiquanti.blogspot.com].
5. Ce sont naturellement les divers arrticles de Karl Epting publiés après la guerre qui ont permis de le qualifier de la sorte. Voir notamment sa contribution au colloque consacré, six ans avant sa mort, à Simone Weil.
6. Frédéric Saenen (article à paraître dans Le Magazine des livres).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, allemagne, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 février 2009
Les Etudes rebatiennes
Association littéraire: Les Etudes Rebatiennes
 Novopress, 5/2/2009 : "Les Deux étendards, chef d’œuvre classique et maudit.
Novopress, 5/2/2009 : "Les Deux étendards, chef d’œuvre classique et maudit.Qu’est-ce qu’un livre classique ? C’est « une œuvre contemporaine de tous les âges » comme le disait Sainte Beuve. Échappant au contexte qui l’a vu naître, sans prétendre illusoirement à l’intemporalité, le classique traverse les modes et les aléas de l’histoire. C’est un texte qui parle à l’intelligence et au cœur. Les deux étendards serait-il resté un classique méconnu du fait de la conspiration du silence engendrée par les opinions politiques scandaleuses de l’auteur ? Nous le pensons. Nous en avons l’intuition.
Mais une intuition, même partagée par des esprits prestigieux, demande à être élaborée. Or, seul le tamis du travail d’exégèse et du commentaire critique que les Etudes rebatiennes se proposent d’engager aujourd’hui permettra, notamment en arrachant la littérature au politique de qui en masque la substance, de transformer cette intuition en certitude incontestable. Nous espérons que la publication d’inédits, de témoignages et d’entretiens, l’organisation de colloques en apporteront les preuves définitives.
C’est pourquoi les Etudes rebatiennes ont été fondées. Elles se donnent pour tâche de contribuer au rayonnement de l’œuvre littéraire de Lucien Rebatet. Les Etudes rebatiennes s’adressent donc aux amoureux de la grande littérature.
La revue
Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles ; actualité rebatiennes ; vie de l’association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu’elles soient œuvres de qualité élaborées par des personnes compétentes. Le premier numéro sortira dans un an.
Renseignements, abonnements : etudesrebatiennes@gmail.com
00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, littérature française, lettres françaises, lettres, littérature, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
A paraître: "Le Testament de Céline"
A paraître : Le testament de Céline
Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/
 La hantise dont Céline est le bâtard par Philippe Delaroche :
La hantise dont Céline est le bâtard par Philippe Delaroche :
"La lecture du Voyage au bout de la nuit produit une commotion. "Quand j'ai lu le Voyage, raconte Paul Yonnet, j'ai été traversé par ce livre, coupé en deux, en trois, en dix..." Il cessa de lire. Et il prit la route - parce que mourir ou partir, il faut choisir. Revenu à la lecture, il continua à s'interdire le Voyage. Jusqu'au jour où, menacé de cécité, le sociologue redouta d'entrer dans la nuit définitive sans avoir dissipé un doute. Il réappareilla à bord du Voyage. Même ravissement ! Livre de la révolte, "le plus complet et le plus achevé de tous les manifestes de l'Anarchie", où la vie des pauvres et la domestication - "le soldat gratuit, ça c'est du nouveau" - prend un relief inouï, le Voyage témoigne du temps où Céline invente une syntaxe pour "la douleur individuelle d'exister" des sociétés modernes.
Mais il a tout dit. L'effet de souffle est perdu dans Mort à Crédit - "roman à tics". Après quoi, toujours plus retranché, Céline vocifère et délire dans la pire solitude "car, explique Yonnet, c'est une solitude qui désidentifie". Mais l'oeuvre n'est pas née de rien. Elle condense destin personnel et fatalité collective. Céline a vingt ans en 1914. La Grande Guerre lui causa une infirmité et des bourdonnements. Il est pacifiste. Que les surenchères nationalistes relancent la guerre, voilà sa hantise. Il deviendra raciste, au motif qu'une même race vivrait en paix et, qu'à l'inverse, les nations métissées, et par là même "contre-nature", seraient des foyers de guerre civile. Manipulées par les Juifs, elles ne songeraient qu'à s'entretuer.
Ce n'est pas parce que le discours est inqualifiable qu'il faut ignorer les ressorts du délire. Chateaubriand prévoyait chez les solitaires des temps futurs "une misanthropie orgueilleuse, qui les conduira à la folie, ou à la mort". Voici Céline et sa torrentueuse colère. Ce qui le rapproche et le distingue de Zola est avéré, Georges Bernanos, autre survivant de 14-18 et issu d'un autre horizon, salua ainsi le Voyage : "Pour nous la question n'est pas de savoir si la peinture de M. Céline est atroce, nous demandons si elle vraie. Elle l'est. " L'accent de vérité s'épuisa, pas l'atrocité du traumatisme. Paul Yonnet rappelle comment, pour avoir vécu ou dénoncé un péril trop écrasant, certains écrivains ont parfois tout perdu - jusqu'à la raison."
Paul Yonnet, Le testament de Céline, Editions de Fallois, 2009.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 février 2009
F. Vitoux: Céline, l'homme en colère
Frédéric Vitoux : Céline, l'homme en colère
 Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com
Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com
Ce volume constitue une édition revue et mise à jour de Céline, paru aux éditions Belfond en 1987.
Présentation de l'éditeur
" Chaque écrivain, chaque intellectuel, chaque maître à penser veut désormais se mesurer à l'auteur du Voyage, le jauger, le juger, l'accabler ou le louer ", estime Frédéric Vitoux, qui fut l'un des premiers à se risquer à cet exercice et qui pose aujourd'hui la question : " Céline serait-il l'auteur le plus notoirement méconnu de la littérature moderne ? " Ecrivain maudit ? Il était célèbre dès la publication de Voyage au bout de la nuit, en 1932. Ecrivain controversé ? Sa gloire n'a cessé de croître depuis sa mort, au point qu'il est aujourd'hui l'un des Français les plus traduits dans le monde. Ecrivain ordurier ? Son style ajouré, éclaté comme de la dentelle, en fait aussi l'un des plus précieux de notre littérature. Ecrivain consacré ? Son œuvre, à l'exception de ses deux premiers romans, reste largement ignorée. Aborder sans jargon les singularités de l'écriture célinienne. Raconter les principales étapes de sa vie. Evoquer sans complaisance aucune le signataire de pamphlets antisémites d'une violence et d'une outrance telles qu'elles indignèrent ou décontenancèrent ses détracteurs comme ses amis : tel est le triple défi relevé par ce livre. Etude objective et dépassionnée, Céline, l'homme en colère se complète de témoignages, d'une bibliographie et d'un index.
Frédéric Vitoux, Céline, l'homme en colère, Ed.Ecriture, 2009.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 février 2009
Un blog consacré à Céline

Un blog consacré à Céline
Céliniens qui êtes aussi des internautes, oyez ! Un blog consacré à Céline est désormais disponible sur la toile. Il propose les entretiens filmés, des émissions télévisées et radiophoniques mais aussi des commentaires variés, des articles de presse, des photographies, des portraits, bref tout ce qu’il est possible de mettre sur Internet ¹.
L’animateur de ce blog, Matthias Gadret, n’est pas (encore) connu des céliniens. La trentaine, licencié en philosophie, « gratte-papier » dans la banlieue parisienne, il se considère comme un simple lecteur de Céline. Simple lecteur peut-être mais passionné si l’on en juge par la richesse de son blog qui accumule les informations en tous genres sur celui qu’il considère de toute évidence comme le contemporain capital. Si on lui demande quel est l’objectif de ce blog, il répond modestement : « Offrir chaque jour un petit quelque chose sur notre auteur favori ». Le plus étonnant, c’est qu’il y parvient si bien que le réflexe quotidien d’aller visiter ce blog devient familier aux internautes céliniens qui le connaissent déjà. L’avantage du blog, dit-il, est que l’outil, simple et souple à utiliser, ne nécessite aucune connaissance technique particulière. Il permet surtout aux lecteurs de réagir aisément à chaque information mise en ligne en déposant un commentaire. À ce propos, Matthias déplore que les internautes céliniens soient aussi discrets alors même que l’anonymat leur est garanti. Le fait que ce blog soit plutôt de droite – particularité peu commune parmi les céliniens déclarés – ne suscite pas davantage de réactions. Il est vrai qu’il se divise en plusieurs sections, dont l’une, centrée sur l’actualité, est davantage lue que les autres. Pas que Céline, en effet : ce fervent du 7ème art en général et de Michel Audiard en particulier propose de savoureux extraits de films mettant en valeur tout le talent du dialoguiste qui était aussi, comme on le sait, un célinien patenté.
Proche de la sensibilité identitaire, Matthias met aussi en ligne d’intéressants documents sur notre patrimoine européen. Fasciné par le Japon, il consacre aussi une part intéressante de son travail à l’empire du Soleil levant. La partie consacrée à la photographie donne à voir de beaux nus artistiques. Celle centrée sur la musique propose classique, chanson française, rock’n’roll’, airs traditionnels, etc. Bref, un blog éclectique à souhait.
En ce qui concerne Céline (qui occupe tout de même une part privilégiée avec plus de 400 « posts »), Matthias Gadret déplore que l’image de l’écrivain se résume encore aujourd’hui à celle d’un « horrible écrivain collabo-nazi-antisémite ». Il n’en veut pour preuve que l’incident survenu récemment à la Médiathèque André Malraux de Strasbourg : une citation bien anodine extraite de Rigodon a dû être effacée en catastrophe suite aux pressions émanant d’une seule personne ². Notre blogueur pense qu’il sera difficile d’aller plus loin dans la bêtise. Et de commenter sur le mode ironique : « “Dieu qu’ils étaient lourds !”, nous disait Céline il y a environ 50 ans. Ils continuent, les bougres... ». Son souhait, pour conclure : « Voir des céliniens avertis (relativement rares sur internet) réagir plus souvent, pour créer le débat, partager leurs impressions, chaque célinien ayant son Céline. » Lecteurs du BC, vous savez ce qu’il vous reste à faire…
Marc LAUDELOUT
1. Blog « Entre guillemets... » ( http://ettuttiquanti.blogspot.com ) comportant dix sections : actualités – Louis-Ferdinand Céline – livres – musique – mémoire – images – japon – humour – film – mots et proverbes.
2. Pour plus de détails, voir Le Bulletin célinien, n° 302, novembre 2008, p. 3.
00:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline, blog, internet |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 23 janvier 2009
L'Apocalypse selon Ferdinand
14 janvier 2009 : http://ettuttiquanti.blogspot.com/
L'Apocalypse selon Ferdinand
 "D'entrée de jeu, soulignons le double niveau d'interprétation qu'on peut donner à cette oeuvre : Féerie est l'expression, par l'image, d'un drame personnel de Ferdinand confondu avec Céline. En outre, ce qui arrive au narrateur, personnage cosmocentrique par excellence, adviendra au reste du monde. Féerie contient des vues sur le passé, le présent, le présent, et l'Histoire future. C'est une Apocalypse - au sens de Révélation - selon Ferdinand.
"D'entrée de jeu, soulignons le double niveau d'interprétation qu'on peut donner à cette oeuvre : Féerie est l'expression, par l'image, d'un drame personnel de Ferdinand confondu avec Céline. En outre, ce qui arrive au narrateur, personnage cosmocentrique par excellence, adviendra au reste du monde. Féerie contient des vues sur le passé, le présent, le présent, et l'Histoire future. C'est une Apocalypse - au sens de Révélation - selon Ferdinand.
"Apocalypse" ne signifie pas seulement les tribulations catastrophiques de la fin des temps, mais la Révélation Johannique - "tout est dans saint Jean!" (1) - qui donne leur sens aux motifs tragiques. [...]
Le prophète de Féerie narre ce qu'il a vu en se disant simple témoin : le point de départ est un bombardement longuement décrit. Céline, qui se réclame de Pline l'Ancien (2) pour son esprit de sacrifice et la minutie de son observation, précise que sa perception des jardins à l'envers de Jules est "rétinien(ne)"... "du phénomène physique (3)". La vision est à la fois naturelle et surnaturelle, car elle s'inscrit dans le temps des devins :
"Confusion des lieux, des temps! Merde! C'est la féerie vous comprenez... Féerie c'est ça... l'avenir! Passé! Faux! Vrai! " (4)
L'Apocalypse célinienne concerne tous les hommes au-delà des continents historiques, tous les temps, elle embrasse présent, passé, avenir. Ainsi, après ce bombardement donné pour authentique, l'un des personnages de Féerie, le baron Solstrice, nie la réalité des faits et s'écrie:
"Il ne s'est rien passé!... vous confondez tout! (...) Il va se passer! oui! certes! il va! il va se passer! (5)
Plus tard, précise le narrateur-prophète, quand viendra le Temps, les hommes comprendront; ils conviendront alors du sérieux de l'observation:
"ils achèteront plus tard mes livres, beaucoup plus tard, quand je serai mort, pour étudier ce que furent les premiers séismes de la fin, (...) Ils savaient pas, ils sauront!..." (6)
"... quand ils déferleront au coeur! quand Técel aura été dit... Pharès! Manès!... alors on entendra quelque chose!... alors les yeux sortiront... "(7)
Source : Denise Aebersold, Goétie de Céline, SEC, 2008.
Notes
1- Féerie pour une autre fois I, p. 81, Pléiade.
2- Pline l'Ancien ou "le naturaliste" (23-79 ap.JC), auteur d'une Histoire naturelle, commandait la flotte romaine de Misène, près de Naples, lorsque eut lieu l'éruption du Vésuve qui anéantit la ville de Pompéi. Voulant observer le volcan de près, il mourut asphyxié par les émanations. L'hommage qui lui est rendu repose sur l'idée sous-jacente qu'un écrivain digne de ce nom paie un lourd tribut à la connaissance... à distance du cratère de feu s'il s'agit de Ferdinand.
3- Féerie II, p.191
4- Féerie I p15
5- Féerie II p144
6- Féerie II p191
7- Féerie II p195
00:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline, philosophie, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 21 janvier 2009
Céline: "Je suis mystique, messianique, fanatique, païen"
Louis-Ferdinand Céline : "je suis mystique, messianique, fanatique", "païen"
 "Breton, je suis mystique, messianique, fanatique tout naturellement - sans effort - absurde - j'ai été élevé tout naturellement en catholique = baptême, première communion, mariage à l'église, etc. (comme 38 millions de Français) La foi ? hum ! c'est autre chose - comme Renan, hélas, comme Chateaubriand, en désespoir... Pire, je suis médecin - Et puis païen par mon adoration absolue pour la beauté physique, pour la santé - Je hais la maladie, la pénitence, le morbide - grec à cet égard totalement - J'adule l'enfance saine - je m'en Pâme - je tomberai facilement éperdument amoureux - je dis amoureux - d'une petite fille de 4 ans en pleine grâce et beauté blonde et santé - je hais la boisson, la fumée, les toxiques - je comprends, je crois l'enthousiasme des Grecs - Cela est fort rare en somme - Ni Popol ni tant d'autres artistes infiniment mieux doués que moi ne ressentent l'appel irrésistible de la jeunesse (même l'extrême jeunesse - saine et joyeuse) pour cela j'ai tant aimé l'Amérique ! la félinité des femmes ! Ah ! Hollywood - Ah - Goldwyn Mayer ! J'aurais donné 10 ans de ma vie pour occuper leurs fauteuils un instant ! Toutes ces déesses à ma merci ! (Renoir était bien aussi de cet avis) - Etalon très modéré, la vue, le palper, m'enchantent à souhait, m'enivrent, m'inspirent - Je donnerais tout Baudelaire pour une nageuse olympique !"
"Breton, je suis mystique, messianique, fanatique tout naturellement - sans effort - absurde - j'ai été élevé tout naturellement en catholique = baptême, première communion, mariage à l'église, etc. (comme 38 millions de Français) La foi ? hum ! c'est autre chose - comme Renan, hélas, comme Chateaubriand, en désespoir... Pire, je suis médecin - Et puis païen par mon adoration absolue pour la beauté physique, pour la santé - Je hais la maladie, la pénitence, le morbide - grec à cet égard totalement - J'adule l'enfance saine - je m'en Pâme - je tomberai facilement éperdument amoureux - je dis amoureux - d'une petite fille de 4 ans en pleine grâce et beauté blonde et santé - je hais la boisson, la fumée, les toxiques - je comprends, je crois l'enthousiasme des Grecs - Cela est fort rare en somme - Ni Popol ni tant d'autres artistes infiniment mieux doués que moi ne ressentent l'appel irrésistible de la jeunesse (même l'extrême jeunesse - saine et joyeuse) pour cela j'ai tant aimé l'Amérique ! la félinité des femmes ! Ah ! Hollywood - Ah - Goldwyn Mayer ! J'aurais donné 10 ans de ma vie pour occuper leurs fauteuils un instant ! Toutes ces déesses à ma merci ! (Renoir était bien aussi de cet avis) - Etalon très modéré, la vue, le palper, m'enchantent à souhait, m'enivrent, m'inspirent - Je donnerais tout Baudelaire pour une nageuse olympique !"
Louis-Ferdinand Céline, lettre à Milton Hindus du 23/08/1947, in Milton Hindus, LF Céline tel que je l'ai vu, L'Herne. (réédité en 2008 sous le titre Rencontre à Copenhague)
Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 janvier 2009
Céline, la peinture et les peintres
Louis-Ferdinand Céline, la peinture et les peintres
Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com
 [Céline par Gen Paul - 1936]
[Céline par Gen Paul - 1936]
"Céline dit plus d'une fois qu'il n'est pas peintre, en ce sens qu'il ne se sent pas personnellement concerné par la peinture comme il l'est par tout ce qui touche à la littérature. En peinture, il n'est au mieux qu'un amateur, et encore, moins sensible aux qualités proprement picturales qu'aux effets affectifs, voire sentimentaux. «Mon Dieu, un Meissonnier moi ça ne me gêne pas, déclare-t-il dans un entretien de 1959, moi je trouve ça joli, moi, La Retraite de Russie, nom de Dieu je ne suis pas capable d'en faire autant. On me montrera un beau chromo, moi, même l'almanach des Postes, je vois ça très bien [...] c'est gentil même. L'Angelus de Millet, moi je trouve pas ça mal du tout (1). »
Tout autodidacte qu'il est, il n'est pourtant pas sans connaissances en matière de peinture. Dans Voyage au bout de la nuit, il cite les noms de Claude Lorrain et de Fragonard, mais chaque fois pour des raisons extra-picturales. De même sa référence cent fois réitérée à l'impressionnisme ne concerne-t-elle pas la peinture en elle-même. Il ne s'agit que de faire comprendre, par comparaison, la révolution qu'il a réalisée dans la prose française en y réintroduisant, sinon la langue parlée populaire, du moins quelque chose de son ton et de sa démarche,de même que l'impressionnisme, en choisissant le plein air, avait rejeté dans le passé la peinture en atelier.
Ce n'est pas qu'il soit dépourvu de goûts personnels, mais les prédilections qu'il marque vont toujours à un sujet ou à une thématique plutôt qu'à une facture ou à un style. Il n'y a guère lieu de s'attarder sur celle qu'il affirme pour Vlaminck (« parmi les peintres, celui qui se rapproche le plus de mon idéal (2) »: elle peut tenir à la fréquentation du peintre chez Lucien Descaves.
La peinture flamande
La prédilection la plus notable et la plus convaincante, parce qu'elle touche à l'imaginaire qui se révèle dans ses romans, est son attachement durable et souvent réaffirmé à la peinture flamande. En décembre 1932, alors qu'il vient de publier Voyage au bout de la nuit, les Bruegel du musée de Vienne sont pour lui une révélation. Il en fait part aussitôt dans une lettre à Léon Daudet, l'un des trois aimés qui l'ont soutenu dans l'affaire du prix Goncourt contre les autres membres du jury. Tout est significatif dans ce passage: le tableau de Bruegel qu'il choisit parmi tous ceux que présente le musée, le titre qu'il substitue à son titre habituel et le commentaire qu'il en fait: «Vous connaissez certainement, Maître, l'énorme fête des Fous de P. Brughel [sic]. Elle est à Vienne. Tout le problème n'est pas ailleurs pour moi.../ je voudrais bien comprendre autre chose -je ne comprends pas autre chose. je ne peux pas. / Tout mon délire est dans ce sens et je n'ai guère d'autres délires (3). »
 La gaucherie et l'insistance de la rédaction témoignent de l'impact qu'a eu sur lui le tableau, en relation étroite avec sa propre inspiration. Il ne peut s'agir que du tableau traditionnellement intitulé Le Combat de Carnaval et de Carême, scène de place publique où d'innombrables petits personnages sont dispersés autour de deux d'entre eux figurés à plus grande échelle, l'un ventru et rubicond, l'autre squelettique et sinistre, tous deux assis, l'un sur un tonneau posé sur des roulettes et poussé par deux acolytes, l'autre sur une plate-forme roulante tirée par un moine et une nonne. Hormis un certain nombre de personnages qui, comme participants d'une fête populaire, relèvent d'une scène de genre, tous les autres, mendiants et estropiés, composent une humanité pitoyable. Cette fête de mi-carême, malgré les déguisements de quelques-uns et les jeux de quelques autres, est tout sauf joyeuse. La vue de ces malheureux qui s'efforcent et font semblant de s'amuser, beaucoup déjà atteints dans leur corps, laisse le spectateur partagé entre la pitié envers leur état et la répulsion qu'inspire la cruauté spontanée de la plupart de leurs amusements. Consciemment ou inconsciemment, Céline retrouve pour les acteurs de cette scène, malgré le décor de place de village, le mot de « fous » qui figure dans le titre donné par Jérôme Bosch - que Céline découvrira apparemment après Bruegel - à un tableau allégorique, La Nef des fous. Il sait qu'une telle vision est le produit d'un «délire »- le mot même qu'il emploie régulièrement pour désigner l'inspiration qui anime ses romans. Trois mois plus tard, il le répétera dans un autre contexte en se disant « bien Brughelien par instinct (4) ». Souligné par les répétitions, le mouvement qui anime les lignes de la lettre à Léon Daudet est déjà celui d'une défense contre le reproche qu'on a commencé à lui faire à propos de Voyage au bout de la nuit, celui de se complaire à évoquer misères et turpitudes des hommes. « Je voudrais bien comprendre autre chose. [ ... ] Je ne peux pas. » Il y reviendra quelques années plus tard dans le prologue de Mort à crédit. Son domaine à lui, comme celui de Bruegel, est celui du grotesque dont l'humanité présente le tableau lorsque, sujette à la mort, elle tente sans le savoir de s'en divertir en faisant souffrir son semblable. Quittant Vienne, Céline voudra garder cette toile sous les yeux dans son appartement parisien sous la forme d'une reproduction qu'il demande à son amie viennoise de lui envoyer. À ce moment, il s'est si bien persuadé de cette proximité artistique avec Bruegel qu'il a oublié qu'il ne l'a découvert qu'après la publication de Voyage au bout de la nuit et que, dans un entretien, il le présente - avec Balzac et Freud ! -comme son maître dans l'écriture du roman (6).
La gaucherie et l'insistance de la rédaction témoignent de l'impact qu'a eu sur lui le tableau, en relation étroite avec sa propre inspiration. Il ne peut s'agir que du tableau traditionnellement intitulé Le Combat de Carnaval et de Carême, scène de place publique où d'innombrables petits personnages sont dispersés autour de deux d'entre eux figurés à plus grande échelle, l'un ventru et rubicond, l'autre squelettique et sinistre, tous deux assis, l'un sur un tonneau posé sur des roulettes et poussé par deux acolytes, l'autre sur une plate-forme roulante tirée par un moine et une nonne. Hormis un certain nombre de personnages qui, comme participants d'une fête populaire, relèvent d'une scène de genre, tous les autres, mendiants et estropiés, composent une humanité pitoyable. Cette fête de mi-carême, malgré les déguisements de quelques-uns et les jeux de quelques autres, est tout sauf joyeuse. La vue de ces malheureux qui s'efforcent et font semblant de s'amuser, beaucoup déjà atteints dans leur corps, laisse le spectateur partagé entre la pitié envers leur état et la répulsion qu'inspire la cruauté spontanée de la plupart de leurs amusements. Consciemment ou inconsciemment, Céline retrouve pour les acteurs de cette scène, malgré le décor de place de village, le mot de « fous » qui figure dans le titre donné par Jérôme Bosch - que Céline découvrira apparemment après Bruegel - à un tableau allégorique, La Nef des fous. Il sait qu'une telle vision est le produit d'un «délire »- le mot même qu'il emploie régulièrement pour désigner l'inspiration qui anime ses romans. Trois mois plus tard, il le répétera dans un autre contexte en se disant « bien Brughelien par instinct (4) ». Souligné par les répétitions, le mouvement qui anime les lignes de la lettre à Léon Daudet est déjà celui d'une défense contre le reproche qu'on a commencé à lui faire à propos de Voyage au bout de la nuit, celui de se complaire à évoquer misères et turpitudes des hommes. « Je voudrais bien comprendre autre chose. [ ... ] Je ne peux pas. » Il y reviendra quelques années plus tard dans le prologue de Mort à crédit. Son domaine à lui, comme celui de Bruegel, est celui du grotesque dont l'humanité présente le tableau lorsque, sujette à la mort, elle tente sans le savoir de s'en divertir en faisant souffrir son semblable. Quittant Vienne, Céline voudra garder cette toile sous les yeux dans son appartement parisien sous la forme d'une reproduction qu'il demande à son amie viennoise de lui envoyer. À ce moment, il s'est si bien persuadé de cette proximité artistique avec Bruegel qu'il a oublié qu'il ne l'a découvert qu'après la publication de Voyage au bout de la nuit et que, dans un entretien, il le présente - avec Balzac et Freud ! -comme son maître dans l'écriture du roman (6).
 Il fera de même avec un autre tableau de Bruegel qu'il découvrira quelque temps plus tard, à Anvers où il est venu voir une autre amie (7). Le sujet de Dulle Griet le touche sans doute de plus près encore, puisqu'il s'agit de scènes de guerre dans lesquelles la légendaire géante « Margot l'Enragée» (désignation habituelle du tableau en français) entraîne ses compatriotes flamandes. Ce que révélait déjà sur les hommes la pacifique « fête des Fous » est ici pleinement et irrécusablement mis en valeur.
Il fera de même avec un autre tableau de Bruegel qu'il découvrira quelque temps plus tard, à Anvers où il est venu voir une autre amie (7). Le sujet de Dulle Griet le touche sans doute de plus près encore, puisqu'il s'agit de scènes de guerre dans lesquelles la légendaire géante « Margot l'Enragée» (désignation habituelle du tableau en français) entraîne ses compatriotes flamandes. Ce que révélait déjà sur les hommes la pacifique « fête des Fous » est ici pleinement et irrécusablement mis en valeur.
L'intérêt pour la peinture flamande ne se démentira pas. En janvier 1936, il visitera l'exposition de l'Orangerie en compagnie de son amie Lucienne Delforge, qui, dans un témoignage, parlera plus tard de l'admiration de Céline pour « la justesse des attitudes, la subtilité du geste ou de l'expression qui permettaient de pénétrer la psychologie des personnages peints par l'artiste, en dehors de la splendeur des couleurs (8)». Ce que Lucienne Delforge nomme ici la« psychologie » est la« folie » humaine que Céline ne se lasse pas de voir illustrée par cette école de peinture. Même lorsqu'il est le plus touché par un peintre, c'est encore davantage par la représentation que par le style.
Dans les années suivantes, peut-être à la suite de cette exposition ou bien après avoir vu ou revu au Louvre La Nef des fous, il remontera jusqu'au maître de Bruegel, Jérôme Bosch. Il s'interrogera sur ce qu'a pu être la vie du peintre pour qu'il en arrive à peindre de tels tableaux. À la même amie anversoise, il demande « quelques renseignements sur la vie de Jérôme Bosch, juste quelques idées (9) », (Et lui, quelle avait été sa vie pour qu'il écrive ces romans?) À la réflexion, il jugera le maître supérieur à l'élève. En 1947, quand il voudra donner une idée de la peinture européenne à son admirateur et défenseur américain Milton Hindus, il écrira: « Bosch Jérôme, le peintre, surpasse de beaucoup Breughel à mon avis - il ose davantage"). »
Deux amis peintres auraient pu offrir à Céline un autre contact avec la peinture, mais, à en croire les lettres de lui qui ont été conservées, il ne s'entretenait guère de peinture avec eux. Avec le peintre décorateur Henri Mahé, son cadet, la complicité repose sur leurs origines bretonnes et sur un échange de propos sur les femmes et le sexe. C'est pour accompagner les fresques dont Mahé avait décoré une maison de plaisir que Céline écrit un petit texte licencieux, « 31 cité d'Antin » (l'adresse parisienne de la maison).
 Gen Paul
Gen Paul
L'intimité va beaucoup plus loin avec l'autre peintre, son voisin montmartrois, Gen Paul. Elle est à la fois profonde et ambivalente, comme le montrera leur brouille d'après-guerre qui se traduira, de la part de Céline, par une évocation très négative de l'artiste, sous le nom de «Jules», dans la seconde partie de son roman Féerie pour une autre fois. Avec lui, pourtant, Céline avait touché de plus près la peinture, et la création plastique en général. Non que, jusqu'à la guerre, il entre si peu que ce soit dans l'expressionnisme violent de la manière de Gen Paul à cette époque, qui le rapproche de Soutine. Mais, déjà, Céline est sensible dans ses dessins à une affinité avec ce que lui-même réalise avec les mots. Deux textes témoignent de son admiration et font de l'artiste l'illustrateur privilégié de ses romans: «J'avoue que Gen Paul avec ses cartons me fait grand plaisir. J'attends chaque nouveau. Je frétille du bout... C'est la seule glace qui me convienne. je m'y retrouve tout immonde et sans dégoût (11).» Deux ans plus tard, il écrira, pour présenter une exposition de Gen Paul prévue à New York, un texte dans lequel il donnera sa peinture comme « authentiquement représentative d'une manière qui est purement et essentiellement française - irrévérencieuse, moqueuse, franche - et pourtant gracieuse, vive et joyeuse (12)».
On ne sait de quelle série de peintures de Gen Paul parle ici Céline. Sur sa manière expressionniste antérieure, il portera dans Féerie pour une autre fois un jugement beaucoup plus défavorable. Mais il se passe alors un phénomène paradoxal qui le rapproche bon gré mal gré de cette peinture.
 [Gen Paul, Le Sacré-Coeur, 1927]
[Gen Paul, Le Sacré-Coeur, 1927]
Le bouleversement cosmique que produit sous ses yeux le bombardement en cours, qui est le sujet de ce roman, lui apparaît comme la réalisation concrète, et même encore exagérée, de cette manière de « jules ». Il ne rappelle d'abord ses premières impressions que pour reconnaître que les événements de cette nuit d'avril 1944 leur apporte rétrospectivement un démenti, dans la mesure où ils réalisent bel et bien, et même davantage encore, ce qu'il prenait alors pour de la pure provocation. « je l'avais vu vernisser ses toiles... moi parfait plouc, aucune autorité d'art, je m'étais dit à moi-même: il le fait exprès! il bluffe le bourgeois! il leur peint des autobus sur la mer de Glace... et les Alpes elles-mêmes en neiges mauve, orange, carmin, et les vaches paissant des couteaux!... des lames d'acier! des poignards en fait d'herbe tendre!...» Mais la réalité est en train de dépasser la fiction - en l'occurrence la vision -, jugée alors artificielle, des tableaux de jules, ce que Céline traduit en termes romanesques en imaginant celui-ci non plus en train de peindre, mais de présider au bombardement par ses gestes du haut de la plate-forme du Moulin de la Galette: «... maintenant il nous sorcelait autre chose! des aravions tonnants, grondants, des escadres entières, et des déluges de mines réelles qui foutaient un bordel au sol, que les immeubles déchaussaient, et les monuments! les mairies! que tout ça s'envolait aux cieux, à la queue leu leu à l'envers! et les couvents! c'était plus terrible que ses gouaches! c'était un petit peu plus osé ! (13) »
À quelqu'un qui, comme lui, ne s'intéressait pas à la peinture pour elle-même et n'avait pas suivi son évolution au XXe siècle, la déformation du réel dans les peintures expressionnistes de Gen Paul avait pu à l'époque paraître gratuite, mais le moment était venu où elle se révélait prophétique, face au tohu-bohu auquel était réduit le monde par l'action conjuguée des bombardiers, avec leurs piqués, leurs loopings, leurs lâchers de bombes, et de la DCA, avec ses pinceaux lumineux et ses tirs. Contre les préjugés de l'ignorance, la peinture trouvait sa justification. Mais le dernier mot restait à la transposition de cette peinture dans le monde du langage, dont Céline prouverait, dans ces quatre romans de l'apocalypse, que la littérature était capable."
Source : Henri Godard, Un autre Céline, de la fureur à la féerie, Ed.Textuel, 2008.
Sur le sujet:
>>> Louis-Ferdinand Céline - Bruegel
Notes
1-Voir aussi l'entretien avec Francine Bloch et Julien Alvard, Cahiers Céline 7, p.435 et 459.
2- Bagatelles pour un massacre, p.216.
3-Lettre à Léon Daudet du 30 décembre 1932, in Appendices, Romans, T.1, p.1108.
4- Lettre à Evelyne Pollet du 5 juin 1933, Cahiers Céline 5, p.166.
5- Lettre à Cillie Ambor du 10 janvier 1933, CAhiers Céline 5, p.91.
6- Cahiers Céline 1, p.41.
7- Lettre à Evelyne Pollet du 5 juin 1933, Cahiers Céline 5, p.171.
8- Cahiers Céline 5, p.258.
9- Lettre à Evelyne Pollet du 20 novembre 1937 Cahiers Céline 5, p.194.
10- Milton Hindus, LF Céline tel que je l'ai vu, lettre du 12 juin 1947.
11- Texte écrit en 1935 pour le bulletin de souscription d'une édition illustrée du Voyage qui ne sera pas réalisée à cette date.
12- Le texte n'étant connu que par sa traduction en anglais, ces mots ne sont pas ceux de Céline mais d'une retraduction en français, Année Céline 1996, p.19.
13- Féerie pour une autre fois, p.223.
00:10 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, france, céline, littérature, lettres, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 09 janvier 2009
Le Bulletin Célinien n°304
Le Bulletin célinien
 Au sommaire du n°304 - janvier 2009 :
Au sommaire du n°304 - janvier 2009 :
Marc Laudelout : Bloc-notes
Henri Godard : Un monument célinien ("Dictionnaire des personnages dans l'œuvre romanesque de Céline")
Marc Laudelout : Le monde de la dédicace
André Rousseaux : Justice pour Céline écrivain (1961)
Deux lettres de Céline à André Rousseaux
Marc Laudelout : À propos de Céline et Karl Epting
Vera Maurice : Les paradoxes de la Rose des Vents
Marc Laudelout : Un blog consacré à Céline
Bulletin célinien
B. P. 70
B 1000 Bruxelles 22
celinebc@skynet.be
15:17 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres françaises, littérature française, lettres, littérature, céline, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 janvier 2009
Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline par J. Morand
Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/
Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline par J. Morand
 Extrait de Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline de Jacqueline Morand, 1972 :
Extrait de Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline de Jacqueline Morand, 1972 :
Le paradoxe. Céline engagé volontaire des deux guerres.
« Ce pacifiste forcené, qui dénonçait si violemment la guerre, la déliant d'un mépris gigantesque, qui allait jusqu'à faire l'apologie de la lâcheté et de la roublardise dans son premier roman et se déclarait en 1938 « objecteur de conscience 700 pour 100 » fut un volontaire des deux guerres, médaillé militaire en 1914, cité à l’Ordre de l'armée, mutilé 75 %. Là réside le paradoxe, la réelle contradiction entre l'œuvre de Céline et sa vie. Un patriotisme d'Epinal ne cessa jamais au fond de l'habiter. Cette première guerre mondiale qu'il jugeait monstrueuse, absurde, et haïssable, il était fier de l'avoir faite avec bravoure, fier des blessures reçues au service de son pays, versant dans ces « sentiments » dont il disait devoir se méfier.
Les dernières pages de Mort à crédit présentent l'engagement à l’armée du jeune L.F. Destouches comme la révolte d'un adolescent qui pense échapper ainsi à l'emprise devenue pesante de sa famille. De fait Céline s'engagea volontairement en 1912 pour une durée de 3 ans. Il put choisir sa garnison, Rambouillet, 12è régiment de cuirassiers. Il avait 18 ans. Maréchal des logis sur le front des Flandres, il fut en novembre 1914 volontaire pour une mission dangereuse à Poekapelle en Flandre occidentale dont il se tira avec bravoure. Grièvement blessé au bras et à la tête, considéré comme invalide à 75%, il fut cité à l’ordre du jour de l’armée et reçut la Médaille militaire. Cet acte héroïque lui valut d’être représenté en couverture de L’Illustré national (10). La gravure montre le jeune Destouches galopant à cheval sous le feu nourri de l’ennemi. La légende inscrite au bas de la gravure explique :
« Le maréchal des logis Destouches, du 12è régiment de cui¬rassiers, a reçu la médaille militaire pour s'être offert spontané¬ment (alors qu'il était en liaison entre un régiment d'infanterie et sa brigade) pour porter, sous un feu violent, un ordre que les agents de liaison d'infanterie hésitaient à transmettre. Après avoir porté cet ordre, il fut malheureusement grièvement blessé au retour de sa mission. »
Ces blessures expliquent qu'il fût affecté, début 1915, à Londres, comme attaché au bureau des passeports, ce qui lui occasionna des rencontres étranges, celle de Mata-Hari entre autres. Il fut, en 1916, envoyé au Cameroun, réformé temporairement et retourna à Londres, versé dans les services de l'Armement. Il obtint en 1917 son deuxième baccalauréat à Bordeaux, fit des tournées de conférences en Bretagne pour la Fondation Rockfeller, en vue de la propagande anti-tuberculeuse, et commença en 1918 ses études de médecine à Rennes. En 1939, Céline, âgé de 45 ans, reprend volontairement du service dans l'armée. Il devient médecin de la marine de guerre (3è classe) et embarque à bord du Shella, un paquebot de la compagnie « Paquet ». Lors d'un trajet Casablanca-Marseille, le bateau est touché par une torpille allemande au large de Gibraltar ; il entre ensuite en collision avec un patrouilleur anglais, le Kingston Cornelian et les deux navires font naufrage. Renfloué, le Shella est coulé par les Allemands en regagnant Marseille.
Où irai-je ? s'interroge Céline dans une lettre envoyée de Gibraltar le 9 jan¬vier 1940 à un de ses amis.
Ah ! le destin se montre féroce en ces jours courants. J'espère que vu ma vaillance et ma discipline, on me découvrira une nouvelle planque où je finirai bien par gagner la timbale des bonnes vies bien mouvementées.
Et de poursuivre avec amertume :
De toi à moi, jamais je ne me suis tant ennuyé. La belle époque tu vois c'était le XVIIIè. On y faisait facilement une vie par semaine. De nos jours dits rapides, on guerroye en limace.
A son retour en France, Céline remplace le médecin mobilisé du dispensaire de Sartrouville. Il accompagne sur les routes de l'exode jusqu'à La Rochelle une ambulance d'enfants qu'il ramènera à Sartrouville en octobre (11). Durant l'occupation, il vit à Paris, rue Girardon et travaille au dispensaire de Bezons. Il quittera Paris pour l'Allemagne, en juillet 1944.
Il y a donc désaccord entre les idées pacifistes de Céline qui logiquement aurait dû le conduire à l'objection de conscience et les réflexes qui le poussèrent à s'engager volontairement une fois la guerre déclarée. Cette contradiction correspond chez lui à l'oppo¬sition entre un antimilitarisme ardent et un patriotisme à la Déroulède, et dans cet affrontement entre l'antimilitarisme qui chez lui tient plutôt de l'idée, et le patriotisme qui relève surtout du sentiment, c'est ce dernier qui l'emporta. Il est à noter aussi que les deux guerres l'ont très différemment marqué : la guerre de 1914 l'a poussé ainsi qu'un grand nombre d'intellectuels de sa génération à un pacifisme véhément. La guerre de 1940 l'a laissé plus indifférent, détachement que procure l'âge, lassitude que crée l'habitude. Le pacifisme de Céline reste étroitement lié à la guerre de 1914, aux corps à corps des poilus, et aux champs couverts de jeunes cadavres en uniformes bleu horizon.
Mais le refus forcené du romancier du Voyage atteint à l'intemporalité et à l'universalité. Il semble inspirer le pacifisme intransigeant de certains mouvements de jeunes des années 1970, en réplique à l'optimisme quelque peu pervers de « la paix par la terreur » ? Au-delà de la soif de fraternité entre les hommes, au-delà des bons sentiments, face à la menace atomique et à la banalisation de la guerre, l'impulsion angoissée de Bardamu s'arroge le droit d'envahir nos sociétés contemporaines. »
Notes
10. Voir, L'Illustré national, Histoire anecdotique de la guerre européenne, novembre 1914.
11. Durant quinze jours, Céline sera médecin à l'hôpital de La Rochelle. On lui proposa alors d'embarquer à bord d'un bateau en par¬tance pour l'Angleterre. Il refusa, ne voulant pas abandonner son ambulance.
A lire:
>>> Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline par J. Morand (1)
>>> Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline par J. Morand (2)
>>> Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline par J. Morand (3)
00:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, théorie politique, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 janvier 2009
Emile Cioran and the Culture of Death
-

- Emile Cioran and the Culture of Death
by Tomislav Sunic
Speech held by the author at the European Synergies' Summer Conference in 2002 (Low Saxony, Germany)
Historical pessimism and the sense of the tragic are recurrent motives in European literature. From Heraclitus to Heidegger, from Sophocles to Schopenhauer, the exponents of the tragic view of life point out that the shortness of human existence can only be overcome by the heroic intensity of living. The philosophy of the tragic is incompatible with the Christian dogma of salvation or the optimism of some modern ideologies. Many modern political theologies and ideologies set out from the assumption that "the radiant future" is always somewhere around the corner, and that existential fear can best be subdued by the acceptance of a linear and progressive concept of history. It is interesting to observe that individuals and masses in our post-modernity increasingly avoid allusions to death and dying. Processions and wakes, which not long ago honored the postmortem communion between the dead and the living, are rapidly falling into oblivion. In a cold and super-rational society of today, someone's death causes embarrassment, as if death should have never occurred, and as if death could be postponed by a deliberate "pursuit of happiness." The belief that death can be outwitted through the search for the elixir of eternal youth and the "ideology of good looks", is widespread in modern TV-oriented society. This belief has become a formula for social and political conduct.
The French-Rumanian essayist, Emile Cioran, suggests that the awareness of existential futility represents the sole weapon against theological and ideological deliriums that have been rocking Europe for centuries. Born in Rumania in 1911, Cioran very early came to terms with the old European proverb that geography means destiny. From his native region which was once roamed by Scythian and Sarmatian hordes, and in which more recently, secular vampires and political Draculas are taking turns, he inherited a typically "balkanesque" talent for survival. Scores of ancient Greeks shunned this area of Europe, and when political circumstances forced them to flee, they preferred to search for a new homeland in Sicily or Italy--or today, like Cioran, in France. "Our epoch, writes Cioran, "will be marked by the romanticism of stateless persons. Already the picture of the universe is in the making in which nobody will have civic rights."[1] Similar to his exiled compatriots Eugène Ionesco, Stephen Lupasco, Mircea Eliade, and many others, Cioran came to realize very early that the sense of existential futility can best by cured by the belief in a cyclical concept of history, which excludes any notion of the arrival of a new messiah or the continuation of techno-economic progress.
Cioran's political, esthetic and existential attitude towards being and time is an effort to restore the pre-Socratic thought, which Christianity, and then the heritage of rationalism and positivism, pushed into the periphery of philosophical speculation. In his essays and aphorisms, Cioran attempts to cast the foundation of a philosophy of life that, paradoxically, consists of total refutation of all living. In an age of accelerated history it appears to him senseless to speculate about human betterment or the "end of history." "Future," writes Cioran, "go and see it for yourselves if you really wish to. I prefer to cling to the unbelievable present and the unbelievable past. I leave to you the opportunity to face the very Unbelievable."[2] Before man ventures into daydreams about his futuristic society, he should first immerse himself in the nothingness of his being, and finally restore life to what it is all about: a working hypothesis. On one of his lithographs, the 16th century French painter, J. Valverde, sketched a man who had skinned himself off his own anatomic skin. This awesome man, holding a knife in one hand and his freshly peeled off skin in the other, resembles Cioran, who now teaches his readers how best to shed their hide of political illusions. Man feels fear only on his skin, not on his skeleton. How would it be for a change, asks Cioran, if man could have thought of something unrelated to being? Has not everything that transpires caused stubborn headaches? "And I think about all those whom I have known," writes Cioran, "all those who are no longer alive, long since wallowing in their coffins, for ever exempt of their flesh--and fear."[3]
The interesting feature about Cioran is his attempt to fight existential nihilism by means of nihilism. Unlike many of his contemporaries, Cioran is averse to the voguish pessimism of modern intellectuals who bemoan lost paradises, and who continue pontificating about endless economic progress. Unquestionably, the literary discourse of modernity has contributed to this mood of false pessimism, although such pessimism seems to be more induced by frustrated economic appetites, and less by what Cioran calls, "metaphysical alienation." Contrary to J.P. Sartre's existentialism that focuses on the rupture between being and non-being, Cioran regrets the split between the language and reality, and therefore the difficulty to fully convey the vision of existential nothingness. In a kind of alienation popularized by modern writers, Cioran detects the fashionable offshoot of "Parisianism" that elegantly masks a warmed-up version of a thwarted belief in progress. Such a critical attitude towards his contemporaries is maybe the reason why Cioran has never had eulogies heaped upon him, and why his enemies like to dub him "reactionary." To label Cioran a philopsher of nihilism may be more appropriate in view of the fact that Cioran is a stubborn blasphemer who never tires from calling Christ, St. Paul, and all Christian clergymen, as well as their secular Freudo-Marxian successors outright liars and masters of illusion. To reduce Cioran to some preconceived intellectual and ideological category cannot do justice to his complex temperament, nor can it objectively reflect his complicated political philosophy. Each society, be it democratic or despotic, as a rule, tries to silence those who incarnate the denial of its sacrosanct political theology. For Cioran all systems must be rejected for the simple reason that they all glorify man as an ultimate creature. Only in the praise of non-being, and in the thorough denial of life, argues Ciroan, man's existence becomes bearable. The great advantage of Cioran is, as he says, is that "I live only because it is in my power to die whenever I want; without the idea of suicide I would have killed myself long time ago."[4] These words testify to Cioran's alienation from the philosophy of Sisyphus, as well as his disapproval of the moral pathos of the dung-infested Job. Hardly any biblical or modern democratic character would be willing to contemplate in a similar manner the possibility of breaking away from the cycle of time. As Cioran says, the paramount sense of beatitude is achievable only when man realizes that he can at any time terminate his life; only at that moment will this mean a new "temptation to exist." In other words, it could be said that Cioran draws his life force from the constant flow of the images of salutary death, thereby rendering irrelevant all attempts of any ethical or political commitment. Man should, for a change, argues Cioran, attempt to function as some form of saprophytic bacteria; or better yet as some amoebae from Paleozoic era. Such primeval forms of existence can endure the terror of being and time more easily. In a protoplasm, or lower species, there is more beauty then in all philosophies of life. And to reiterate this point, Cioran adds: "Oh, how I would like to be a plant, even if I would have to attend to someone's excrement!"[5]
Perhaps Cioran could be depicted as a trouble maker, or as the French call it a "trouble fête", whose suicidal aphorisms offend bourgeois society, but whose words also shock modern socialist day-dreamers. In view of his acceptance of the idea of death, as well as his rejection of all political doctrines, it is no wonder that Cioran no longer feels bound to egoistical love of life. Hence, there is no reason for him to ponder over the strategy of living; one should rather start thinking about the methodology of dying, or better yet how never to be born. "Mankind has regressed so much," writes Cioran, and "nothing proves it better than the impossibility to encounter a single nation or a tribe in which a birth of a child causes mourning and lamentation."[6] Where are those sacred times, inquires Cioran, when Balkan Bogumils and France's Cathares saw in child's birth a divine punishment? Today's generations, instead of rejoicing when their loved ones are about to die, are stunned with horror and disbelief at the vision of death. Instead of wailing and grieving when their offsprings are about to be born, they organize mass festivities:
If attachment is an evil, the cause of this evil must be sought in the scandal of birth--because to be born means to be attached. The purpose of someone's detachment should be the effacement of all traces of this scandal--the ominous and the least tolerable of all scandals.[7]
Cioran's philosophy bears a strong imprint of Friedrich Nietzsche and Indian Upanishads. Although his inveterate pessimism often recalls Nietzsche's "Weltschmerz," his classical language and rigid syntax rarely tolerates romantic or lyrical narrative, nor the sentimental outbursts that one often finds in Nietzsche's prose. Instead of resorting to thundering gloom, Cioran's paradoxical humor expresses something which in the first place should have never been verbally construed. The weakness of Cioran prose lies probably in his lack of thematic organization. At time his aphorisms read as broken-off scores of a well-designed musical master piece, and sometimes his language is so hermetic that the reader is left to grope for meaning.
When one reads Cioran's prose the reader is confronted by an author who imposes a climate of cold apocalypse that thoroughly contradicts the heritage of progress. Real joy lies in non-being, says Cioran, that is, in the conviction that each willful act of creation perpetuates cosmic chaos. There is no purpose in endless deliberations about higher meaning of life. The entire history, be it the recorded history or mythical history, is replete with the cacophony of theological and ideological tautologies. Everything is "éternel retour," a historical carousel, with those who are today on top, ending tomorrow at the bottom.
I cannot excuse myself for being born. It is as if, when insinuating myself in this world, I profaned some mystery, betrayed some very important engagement, made a mistake of indescribable gravity.[8]
This does not mean that Cioran is completely insulated from physical and mental torments. Aware of the possible cosmic disaster, and neurotically persuaded that some other predator may at any time deprive him of his well-planned privilege to die, he relentlessly evokes the set of death bed pictures. Is this not a truly aristocratic method to alleviate the impossibility of being?:
In order to vanquish dread or tenacious anxiety, there is nothing better than to imagine one's own funeral: efficient method, accessible to all. In order to avoid resorting to it during the day, the best is to indulge in its virtues right after getting up. Or perhaps make use of it on special occasions, similar to Pope Innocent IX who ordered the picture of himself painted on his death-bed. He would cast a glance at his picture every time he had to reach an important decision... [9]
At first, one may be tempted to say that Cioran is fond of wallowing in his neuroses and morbid ideas, as if they could be used to inspire his literary creativity. So exhilarating does he find his distaste for life that he suggests that, "he who succeeds in acquiring them has a future which makes everything prosper; success as well as defeat."[10] Such frank description of his emotional spasms makes him confess that success for him is as difficult to bear as much as a failure. One and the other cause him headache.
The feeling of sublime futility with regard to everything that life entails goes hand in hand with Cioran's pessimistic attitude towards the rise and fall of states and empires. His vision of the circulation of historical time recalls Vico's corsi e ricorsi, and his cynicism about human nature draws on Spengler's "biology" of history. Everything is a merry-go-round, and each system is doomed to perish the moment it makes its entrance onto the historical scene. One can detect in Cioran's gloomy prophecies the forebodings of the Roman stoic and emperor Marcus Aurelius, who heard in the distance of the Noricum the gallop of the barbarian horses, and who discerned through the haze of Panonia the pending ruin of the Roman empire. Although today the actors are different, the setting remains similar; millions of new barbarians have begun to pound at the gates of Europe, and will soon take possession of what lies inside:
Regardless of what the world will look like in the future, Westerners will assume the role of the Graeculi of the Roman empire. Needed and despised by new conquerors, they will not have anything to offer except the jugglery of their intelligence, or the glitter of their past. [11]
Now is the time for the opulent Europe to pack up and leave, and cede the historical scene to other more virile peoples. Civilization becomes decadent when it takes freedom for granted; its disaster is imminent when it becomes too tolerant of every uncouth outsider. Yet, despite the fact that political tornados are lurking on the horizon, Cioran, like Marcus Aurelius, is determined to die with style. His sense of the tragic has taught him the strategy of ars moriendi, making him well prepared for all surprises, irrespective of their magnitude. Victors and victims, heroes and henchmen, do they not all take turns in this carnival of history, bemoaning and bewailing their fate while at the bottom, while taking revenge when on top? Two thousand years of Greco-Christian history is a mere trifle in comparison to eternity. One caricatural civilization is now taking shape, writes Cioran, in which those who are creating it are helping those wishing to destroy it. History has no meaning, and therefore, attempting to render it meaningful, or expecting from it a final burst of theophany, is a self-defeating chimera. For Cioran, there is more truth in occult sciences than in all philosophies that attempt to give meaning to life. Man will finally become free when he takes off the straitjacket of finalism and determinism, and when he realizes that life is an accidental mistake that sprang up from one bewildering astral circumstance. Proof? A little twist of the head clearly shows that "history, in fact, boils down to the classification of the police: "After all, does not the historian deal with the image which people have about the policeman throughout epochs ?"[12] To succeed in mobilizing masses in the name of some obscure ideas, to enable them to sniff blood, is a certain avenue to political success. Had not the same masses which carried on their shouldered the French revolution in the name of equality and fraternity, several years later also brought on their shoulders an emperor with new clothes--an emperor on whose behalf they ran barefoot from Paris to Moscow, from Jena to Dubrovnik? For Cioran, when a society runs out of political utopia there is no more hope, and consequently there cannot be any more life. Without utopia, writes Cioran, people would be forced to commit suicide; thanks to utopia they commit homicides.
Today there are no more utopias in stock. Mass democracy has taken their place. Without democracy life makes little sense; yet democracy has no life of its own. After all, argues Cioran, had it not been for a young lunatic from the Galilee, the world would be today a very boring place. Alas, how many such lunatics are hatching today their self-styled theological and ideological derivatives! "Society is badly organized, writes Cioran, "it does nothing against lunatics who die so young."[13] Probably all prophets and political soothsayers should immediately be put to death, "because when the mob accepts a myth--get ready for massacres or better yet for a new religion."[14]
Unmistakable as Cioran's resentments against utopia may appear, he is far from deriding its creative importance. Nothing could be more loathsome to him than the vague cliche of modernity that associates the quest for happiness with a peaceful pleasure-seeking society. Demystified, disenchanted, castrated, and unable to weather the upcoming storm, modern society is doomed to spiritual exhaustion and slow death. It is incapable of believing in anything except in the purported humanity of its future blood-suckers. If a society truly wishes to preserve its biological well-being, argues Cioran, its paramount task is to harness and nurture its "substantial calamity;" it must keep a tally of its own capacity for destruction. After all, have not his native Balkans, in which secular vampires are today again dancing to the tune of butchery, also generated a pool of sturdy specimen ready for tomorrow's cataclysms? In this area of Europe, which is endlessly marred by political tremors and real earthquakes, a new history is today in the making--a history which will probably reward its populace for the past suffering.
Whatever their past was, and irrespective of their civilization, these countries possess a biological stock which one cannot find in the West. Maltreated, disinherited, precipitated in the anonymous martyrdom, torn apart between wretchedness and sedition, they will perhaps know in the future a reward for so many ordeals, so much humiliation and for so much cowardice.[15]
Is this not the best portrayal of that anonymous "eastern" Europe which according to Cioran is ready today to speed up the world history? The death of communism in Eastern Europe might probably inaugurate the return of history for all of Europe. Conversely, the "better half" of Europe, the one that wallows in air-conditioned and aseptic salons, that Europe is depleted of robust ideas. It is incapable of hating and suffering, and therefore of leading. For Cioran, society becomes consolidated in danger and it atrophies in peace: "In those places where peace, hygiene and leisure ravage, psychoses also multiply... I come from a country which, while never learning to know the meaning of happiness, has also never produced a single psychoanalyst."[16] The raw manners of new east European cannibals, not "peace and love" will determine the course of tomorrow's history. Those who have passed through hell are more likely to outlive those who have only known the cozy climate of a secular paradise.
These words of Cioran are aimed at the decadent France la Doulce in which afternoon chats about someone's obesity or sexual impotence have become major preoccupations on the hit-parade of daily concerns. Unable to put up resistance against tomorrow's conquerors, this western Europe, according to Cioran, deserves to be punished in the same manner as the noblesse of theancien régime which, on the eve of the French Revolution, laughed at its own image, while praising the image of the bon sauvage. How many among those good-natured French aristocrats were aware that the same bon sauvage was about to roll their heads down the streets of Paris? "In the future, writes Cioran, "if mankind is to start all over again, it will be with the outcasts, with the mongols from all parts, with the dregs of the continents.."[17] Europe is hiding in its own imbecility in front of an approaching catastrophe. Europe? "The rots that smell nice, a perfumed corpse." [18]
Despite gathering storms Cioran is comforted by the notion that he at least is the last heir to the vanishing "end of history." Tomorrow, when the real apocalypse begins, and as the dangers of titanic proportions take final shape on the horizon, then, even the word "regret" will disappear from our vocabulary. "My vision of the future," continues Cioran is so clear, "that if I had children I would strangle them immediately."[19]
*~*~*~*~*~*~*
After a good reading of Cioran's opus one must conclude that Cioran is essentially a satirist who ridicules the stupid existential shiver of modern masses. One may be tempted to argue that Cioran offers aan elegant vade-mecum for suicide designed for those, who like him, have thoroughly delegitimized the value of life. But as Cioran says, suicide is committed by those who are no longer capable of acting out optimism, e.g. those whose thread of joy and happiness breaks into pieces. Those like him, the cautious pessimists, "given that they have no reason to live, why would they have a reason to die?" [20] The striking ambivalence of Cioran's literary work consists of the apocalyptic forebodings on the one hand, and enthusiastic evocations of horrors on the other. He believes that violence and destruction are the main ingredients of history, because the world without violence is bound to collapse. Yet, one wonders why is Cioran so opposed to the world of peace if, according to his logic, this peaceful world could help accelerate his own much craved demise, and thus facilitate his immersion into nothingness? Of course, Cioran never moralizes about the necessity of violence; rather, in accordance with the canons of his beloved reactionary predecessors Josephe de Maistre and Nicolo Machiavelli, he asserts that "authority, not verity, makes the law," and that consequently, the credibility of a political lie will also determine the magnitude of political justice. Granted that this is correct, how does he explain the fact that authority, at least the way he sees it, only perpetuates this odious being from which he so dearly wishes to absolve himself? This mystery will never be known other than to him. Cioran admits however, that despite his abhorrence of violence, every man, including himself is an integral part of it, and that every man has at least once in his life contemplated how to roast somebody alive, or how to chop off someone's head:
Convinced that troubles in our society come from old people, I conceived the plan of liquidating all citizens past their forties--the beginning of sclerosis and mummification. I came to believe that this was the turning point when each human becomes an insult to his nation and a burden to his community... Those who listened to this did not appreciate this discourse and they considered me a cannibal... Must this intent of mine be condemned? It only expresses something which each man, who is attached to his country desires in the bottom of his heart: liquidation of one half of his compatriots.[21]
Cioran's literary elitism is unparalleled in modern literature, and for that reason he often appears as a nuisance for modern and sentimental ears poised for the lullaby words of eternal earthly or spiritual bliss. Cioran's hatred of the present and the future, his disrespect for life, will certainly continue to antagonize the apostles of modernity who never tire of chanting vague promises about the "better here-and-now." His paradoxical humor is so devastating that one cannot take it at face value, especially when Cioran describes his own self. His formalism in language, his impeccable choice of words, despite some similarities with modern authors of the same elitist caliber, make him sometimes difficult to follow. One wonders whether Cioran's arsenal of words such as "abulia," "schizophrenia," "apathy," etc., truly depict a nevrosé which he claims to be.
If one could reduce the portrayal of Cioran to one short paragraph, then one must depict him as an author who sees in the modern veneration of the intellect a blueprint for spiritual gulags and the uglification of the world. Indeed, for Cioran, man's task is to wash himself in the school of existential futility, for futility is not hopelessness; futility is a reward for those wishing to rid themselves of the epidemic of life and the virus of hope. Probably, this picture best befits the man who describes himself as a fanatic without any convictions--a stranded accident in the cosmos who casts nostalgic looks towards his quick disappearance.
To be free is to rid oneself forever from the notion of reward; to expect nothing from people or gods; to renounce not only this world and all worlds, but salvation itself; to break up even the idea of this chain among chains. (Le mauvais demiurge, p. 88.)
Notes:
[1] Emile Cioran, "Syllogismes de l'amertume" (Paris: Gallimard, 1952), p. 72 (my translation) return to text
[2] "De l'inconvénient d'être né" (Paris: Gallimard, 1973), p. 161-162. (my translation) (The Trouble with Being Born, translated by Richard Howard: Seaver Bks., 1981) return to text
[3] Cioran, "Le mauvais démiurge" ( Paris: Gallimard, 1969), p. 63. (my translation) return to text
[4] "Syllogismes de l'amertume", p. 87. (my trans.) return to text
[5] Ibid., p. 176. return to text
[6] "De l'inconvénient d'être né", p. 11. (my trans.) return to text
[7] Ibid., p. 29. return to text
[8] Ibid., p. 23. return to text
[9] Ibid., p. 141. return to text
[10] "Syllogismes de l'amertume", p. 61. (my trans.) return to text
[11] "La tentation d'exister", (Paris: Gallimard, 1956), p. 37-38. (my trans.) (The temptation to exist, translated by Richard Howard; Seaver Bks., 1986) return to text
[12] "Syllogismes de l'amertume", p. 151. (my trans.) return to text
[13] Ibid., p. 156. return to text
[14] Ibid., p. 158. return to text
[15] "Histoire et utopie" (Paris: Gallimard, 1960), p. 59. (my trans.) ( History and Utopia, trans. by Richard Howard, Seaver Bks., 1987). return to text
[16] Syllogismes de l'amertume, p. 154. (my trans.) return to text
[17] Ibid., p. 86. return to text
[18] "De l'inconvénient d'être né", p. 154. (my trans.) return to text
[19] Ibid. p. 155. return to text
[20] "Syllogismes de l'amertume", p. 109. return to text
[21] "Histoire et utopie" (Paris: Gallimard, 1960), p. 14. (my trans.) return to text
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roumanie, france, lettres françaises, littérature française, lettres roumaines, littérature roumaine, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



